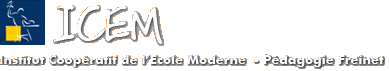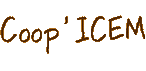L'Ecole laïque française est un vaste corps de 150 à 200 mille éducateurs qu'il serait bien difficile de cataloguer sous une tendance pédagogique uniforme.
Disons tout de suite que l'application et le dévouement des instituteurs et des institutrices est ici hors de cause. Un maître appliquant encore à 100 % les méthodes traditionnelles peut faire son travail avec une conscience et un dévouement exemplaires. Ils y ont parfois plus de mérite encore parce qu'ils font dans des conditions qu'on ne devrait pas accepter, un travail inhumain et désespérant, qui n’est que rarement illuminé par cette flamme d'enthousiasme et d'espoir que nous avons rallumée au sein de l'Ecole Moderne.
Ajoutons que nous ne sommes pas obnubilés par nos succès jusqu'à croire qu'il ne peut y avoir de pédagogie efficiente hors de nos techniques. Il y a, en éducation, toutes les nuances. Le milieu, le nombre des enfants, la personnalité de l’éducateur peuvent déterminer largement le climat et la valeur d'une classe, et il y a, nous le savons, des classes encore traditionnelles qui sont supérieures comme rendement et comme esprit à certaines classes apparemment modernisées.
Mais lorsque nous voulons parler de la masse de nos 150 000 classes, il nous faut bien essayer de dégager des dominantes. Disons en gros — des statistiques pourraient mieux préciser ces pourcentages — qu'il y a actuellement 8 à 10 000 classes (disons environ 7 %) qui pratiquent d’une façon régulière, sans que ce soit à 100 %, les Techniques Freinet; que 30 000 classes environ connaissent nos techniques, essaient de s’en informer, s'abonnent à nos publications, pratiquent — sans abandonner les méthodes traditionnelles — quelques-unes de nos techniques : le texte libre, la correspondance, le fichier, le dessin libre, le plan de travail, le calcul libre, etc... Disons donc 20 % environ. Au total 27 %. Ce qui n'est certes pas négligeable, ni décourageant : au contraire.
Mais restent néanmoins 73 % d’éducateurs qui sont encore en plein dans les techniques traditionnelles, les trouvent acceptables et bonnes et n'éprouvent pas encore le besoin d'en changer. Disons que 10 % d’entre eux sont des maîtres ou des maîtresses exceptionnels, qui, même avec des méthodes déficientes sont en mesure de faire un travail auquel nous rendons hommage.
Mais il resterait 63 % de maîtres et maîtresses travaillant honnêtement et consciencieusement certes, mais dans des conditions et avec des méthodes telles que le rendement en est nettement déficient. C'est la masse des classes dominées par le nombre, dans des écoles aux effectifs excessifs pour une surface et un volume insuffisants, qui emploient à 100 % les méthodes traditionnelles avec tous leurs corollaires, C’est pour ces 63 % que sont rédigées les circulaires telle celle pour le par cœur, que sont publiés les manuels qui apparaissent dans ces conditions comme le seul matériel possible ; que sont édités les journaux pédagogiques qui négligent totalement nos 27 %, telle L'Ecole Libératrice qui s'abstient systématiquement de parler de nos techniques.
Alors un problème se pose aujourd’hui à nous, un problème de conscience professionnelle, sociale et civique.
Jusqu’à ce jour nous avons considéré l’Ecole laïque comme un bloc dont nous étions solidaires, et nous nous sommes abstenus de critiquer dans le détail des techniques et des pratiques que nous aurions dû dénoncer. Si 73 % du personnel de l’entreprise Education travaillent dans des conditions défectueuses, vieilles de 50 à 100 ans, avec des outils désuets qui devraient depuis longtemps avoir rejoint dans les musées et les hangars les charrues ou les calèches qui leur sont contemporains, devons-nous continuer à laisser croire que leurs pratiques ne nuisent vraiment pas à l'efficience et au rendement de notre Ecole ? Et nous l'avons si bien laissé croire que lorsque les administrateurs constatent la mauvaise préparation des enfants qui abordent le second degré, ils préconisent le retour aux méthodes du passé : l'autorité formelle, les examens et le par coeur, comme si la masse des 73 % d'écoles traditionnelles les avaient un tant soit peu abandonnées.
Pour si paradoxal que cela paraisse on punit dans 73 % dos classes, et la diversité des punitions — on n'a rien inventé — nous reporte 80 ans en arrière. Dans ces 73 % de classes on fait des leçons — sur la base des manuels — auxquelles les enfants ne comprennent que fort peu de choses ; on fait réciter par cœur ; on fait copier à longueur de journée et les lignes, les verbes, le piquet, les bons points, les notes et classements, et même le bonnet d'âne restent courants. Et nous ne disons rien. Les parents s'inquiètent, mais comme nous nous taisons, ils pensent qu'ils sont tout simplement victimes d'une grave anomalie et ils se taisent aussi.
Il n’y a pas de raison que, dans ces conditions, cesse un état de choses qui semble satisfaire la grande masse des usagers et les éducateurs eux-mêmes.
Devons-nous continuer ce silence complice, évidemment nuisible à l'Ecole ou bien dirons-nous ce qui est, faisant écho de ce fait à de très nombreux parents qui cherchent pour l'éducation de leurs enfants des solutions plus efficientes.
La question s'était posée déjà lorsque, il y a quatre cinq ans nous avions, avec Oury, dénoncé les méfaits de l'Ecole caserne parisienne, avec sa concentration hallucinante, ses interdictions monstrueuses, ses punitions dignes des camps de concentration. Nous avons soulevé, timidement, un coin de voile. On n'avait pas trop osé nous attaquer parce qu'on ne risquait pas de contredire nos affirmations. La question vaut d'être reprise et continuée.
Nous ferions écho à celte plainte d'une maman nous disant sa peine devant le désarroi de son enfant qu’elle abandonnait un matin parmi la masse d'une école surchargée. Elle l'a vu s’en aller dans le fond, seul au milieu de 45 autres enfants, croiser les bras alors qu'à sa chaire le maître ouvrait sa classe, anonymement. Elle en a pleuré.
Nous avons souvent cité le cas d’une enfant de 3 ans qui nous était chère, élevée selon nos principes et dessinant déjà avec émotion, ouverte et joyeuse. Elle est allée à l’Ecole maternelle voisine où les mouvements se faisaient au commandement et où elle passait une matinée à colorier une banane dont le dessin avait été imprimé au tampon caoutchouc. Elle s’est refermée en quelques jours comme une fleur saccagée.
On me dit que ces écoles sont l'exception et je connais en effet les grands progrès réalisés à l’Ecole maternelle. Et cependant si les marchands de tampons en vendent tellement, il faut croire qu'il est de nombreuses maîtresses qui s'en servent, comme elles se servent de cette profusion ahurissante de jouets dont nous reprendrons un jour prochain le procès.
Il y aurait à dénoncer certes la diversité incroyable des punitions encore employées, Chaque année nous demandons à nos élèves comment se maintenait la discipline dans les écoles qu’ils ont fréquentées. 90 % d'entre eux se plaignent de pratiques dont nous n’avons jamais osé faire état.
Et il y a les formes de travail.
Nous reprendrions dans le détail l'examen de l’école telle qu'elle se pratique habituellement sur la base des leçons, des exercices et des récitations ; nous montrerions le travail effectif fait par des enfants moyennement intelligents au cours d’une journée de classe et nous comparerions avec l'activité intense de nos écoles.
Nous aurions à faire le procès des cahiers trop bien tenus qui impressionnent parents et inspecteurs et où tout est copié pour qu'il n’y ait pas d'erreur, des rédactions préparées et qui semblent satisfaisantes mais où rien n'est l'œuvre des enfants eux-mêmes. Nous discuterons de l'utilité pour les C.E.G. par exemple de la tenue par une élève que j'ai connue de 14 cahiers. Quand je prenais le cahier d'histoire par exemple, je le trouvais au premier abord riche et soigné, avec titres à l'encre rouge et traits à la règle. Mais en y regardant de près je m’apercevais qu’il n’était qu’une copie du manuel, et que l'élève avait, ce faisant, royalement perdu son temps, sauf qu’elle avait appris à copier.
Les instituteurs objecteront alors que, dans les données actuelles de l'Ecole, avec les outils et les techniques dont ils disposent, dans le cadre de certaines Instructions ministérielles, ils ne peuvent pas faire mieux. Ce qui est souvent exact. Mais cela nous devons le dire et ils doivent le dire avec nous. Nous devons, en bons ouvriers, étudier notre machine, en signaler les pièces défectueuses ou les principes démodés afin que, la sachant, les usagers eux-mêmes en demandent l'amélioration.
Au point où nous en sommes, il y a là croyons- nous une besogne d'examen critique impitoyable qu'il faut nécessairement mener. Cette critique, ces mises au point, serviront tous les bons ouvriers intéressés au même titre, ainsi que les parents, à la réalisation en 1961 d'une pédagogie 1961, pour préparer en l'enfant l'homme de demain.
Qu'en pensez-vous? Devons-nous entreprendre cette action ? Si oui, au travail, avec l’aide non seulement des éducateurs et dos parents Ecole Moderne, mais aussi avec les témoignages de ceux de nos collègues qui sont encore dans la place et se demandent bien souvent comment ils parviendront à s’en dégager pour continuer humainement un métier qu'ils aiment mais qui désormais les excède.
J'attends vos lettres.
C. FREINET.