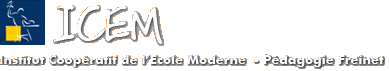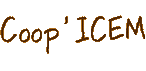Vous êtes-vous demandé parfois pourquoi le renard capturé vivant dépérit et meurt dans sa prison, quels que soient la science et le soin qu’on apporte à lui offrir la nourriture qui lui est d’ordinaire spécifique ? Pourquoi le moineau ne supporte pas davantage la captivité et quel instinct plus fort que le besoin de vivre pousse certaines espèces à se laisser mourir de faim plutôt que de s’accommoder de barrières et de grillages ?
Vous concluez philosophiquement : « Ils ne vivent pas en cage... on ne peut pas les apprivoiser ! »
Et avez-vous pensé qu’il en était peut-être de même pour les enfants, du moins pour ceux — et la proportion en est plus forte qu'on ne croit — que le dressage ou l’atavisme ne sont point parvenus à résigner à l’obéissance et à la passivité : ils entendent toujours distraitement les mots que vous prononcez et regardent de leurs yeux vagues, par-delà les barreaux... de la fenêtre le monde libre dont ils gardent à jamais la nostalgie. Vous dites : « Ils sont dans la lune »... Ils sont dans leur réalité, dans la réalité de leur vie et c’est vous qui passez à côté avec votre vacillant lumignon.
Ils ne font pas, au propre, la grève de la faim. Et encore faudrait-il s’assurer que certains troubles ou certaines épidémies ne sont pas la conséquence d’une perte de vitesse d’un organisme qui n'est plus dans son élément. Mais la grève de la faim intellectuelle, spirituelle et morale est patente, quoiqu’inconsciente. Ils étaient hors de leur cage d’une curiosité inextinguible. Ici, ils n’ont plus faim. Vous accusez en vain le manque de volonté, l’intelligence réduite, une distraction congénitale dont les psychologues et les psychiatres étudient les causes et les remèdes.
Ils dépérissent, tout simplement, comme les bêtes capturées. S’ils n’en meurent pas toujours, physiologiquement et intellectuellement, ce n’est certainement point par faute de mesures de surveillance et de coercition de la part des geôliers mais parce que l’Ecole n’a pas pu jusqu’à ce jour verrouiller ses domaines et que les moineaux un instant libérés s’égaillent à nouveau, dès le son de cloches, dans la richesse vivante de la grande expérience humaine.
Bien sûr, il y a la réussite de ceux qui se sont « apprivoisés ». Est-elle tellement plus spectaculaire que celle des hommes et des femmes qui n'ont pas accepté la prison, même fleurie, et qui, dans la vie se sont révélés d’attaque en face des éléments ?
Alors, faut-il les laisser dans la jungle de l’ignorance et renoncer à cette culture née de l’Ecole qu’ils se refusent à accepter ?
Le dilemme est mal posé : entre l’état sauvage et le dressage, il y a, en intermédiaire la création d’un climat, d’une atmosphère, des normes d’organisation, de vie et de travail en commun, une éducation dont seront exclus le mensonge et la ruse et cette peur instinctive et cette insupportable obsession des bêtes sauvages et des enfants de voir se refermer derrière eux les portes de la lumière et de la liberté.