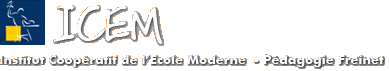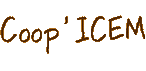Pour servir à la discussion du thème du Congrès de Caen :
L’enseignement des sciences
On disait que le XXe siècle serait le siècle de l’enfant.
Il est surtout le siècle de la science triomphante. Chaque jour naissent de nouvelles théories, se développent les connaissances, se multiplient les possibilités mécaniques. Nous assistons à une véritable ivresse d'inventions dont l’astronautique est comme un exaltant symbole.
L'enfant et l'adolescent sont inévitablement passionnés par cet essor extraordinaire d'un machinisme qui décuple les vitesses, fouille l'infiniment petit et affronte l'infiniment grand jusqu'à donner aux hommes une puissance constructive — et hélas ! aussi, destructive — qui leur vaut l'illusion de se mesurer aux dieux.
De ce fait, la culture scientifique qui, au siècle dernier, pouvait se contenter de la simple tradition empirique, devient aujourd'hui un des éléments majeurs et indispensables de la formation des hommes de 1962.
Par la radio, les disques et la télévision, la grande masse des travailleurs jugera peut-être désuète un jour prochain la culture littéraire actuelle. Mais quiconque n'aura pas acquis la culture scientifique nécessaire dans une société de plus en plus mécanisée, sera incapable d'affronter le monde contemporain.
Ce sont là des faits évidents sur lesquels il est superflu, pensons-nous, de discuter.
Le milieu et l'école à tous les degrés préparent-ils les enfants et les adolescents à vivre demain en hommes dans un monde scientifique ?
Je crois que nous pouvons répondre aussi, sans hésitation ni discussion, par la négative.
La formation scientifique de nos élèves est toute à reconsidérer. C’est cette reconsidération tout à la fois théorique et technique que nous voudrions étudier dans les pages qui suivent.
Nous y sommes quelque peu habilités par le long travail de recherche que nous poursuivons depuis trente ans au sein du mouvement de l'Ecole Moderne.
Nous ne voulons pas prendre exagérément figure de prophète, mais l'idée même de modernisation, dont nous nous sommes fait un drapeau, dit assez que ce problème nous est familier. Nos lecteurs sont désormais habitués à l'idée qu'on ne doit pas travailler à l'Ecole au temps des autos et des spoutniks, comme nous travaillions au début du siècle, à l’ère des chars à bancs, et qu'une éducation ne remplit point son rôle social et humain si elle n’éclaire la route hardie des générations qui viennent.
Dans un livre qui vient de paraître, « L'explosion scolaire » M. Louis Gros, directeur de l'Administration Générale au Ministère de ¡'Education Nationale, dit aussi cette nécessité de modernisation : « A une cadence sans cesse plus rapide, les modes de vie évoluent, les structures professionnelles se modifient, les relations internationales se transforment. Et cet immense bouleversement des mœurs et des pouvoirs des hommes aboutit à une même nécessité fondamentale : la civilisation nouvelle, qui naît sous nos yeux dans les nations industrialisées exige une instruction infiniment plus étendue et infiniment plus répandue qu'autrefois ».
Il est aujourd'hui théoriquement admis qu’on ne prépare pas les voyages sur la lune avec l'étude par cœur de résumés de sciences ou par l’examen sur les croquis des manuels, des observations et des expériences menées par les adultes ; que la formation scientifique est, comme toute formation d’ailleurs, à base d'expériences effectives, avec leur part d'inconnues et donc leurs risques d'échecs et d'erreurs ; qu’elle est une attitude de l'esprit qui ne se contente pas de croire, mais veut agir sur le milieu ambiant pour le transformer en élément actif de progrès.
Les choses changent quand il s’agit de faire passer ces théories dans la pratique. Contre la tradition tenace, l'expérience et le bon sens sont désormais en défaut. La critique que nous devons faire au préalable de la formation scientifique actuelle se heurte au parti-pris et à la partialité de toute l'organisation scolastique.
Mais la vie triomphera.
CRITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL DES SCIENCES
Nous avons dit bien souvent que nous ne sommes pas des théoriciens et que, par conséquent, dominés par notre souci exclusif d'efficience pratique dans nos classes, nous ne saurions avoir de position a priori. Nous ne recherchons point le changement pour le changement, ni la nouveauté pour la nouveauté ; quand ce qui existe nous convient, nous sommes trop heureux de nous en saisir et d'en profiter.
Si renseignement actuel des sciences nous donnait satisfaction, nous n'aurions aucune raison de lui chercher des améliorations et la présente étude serait superflue. C’est parce qu'il convient, ou semble convenir à certains éducateurs travaillant exclusivement dans le cadre scolastique que nous rencontrons tant de peine à nous faire entendre, même quand nous parlons avec bon sens de nos méthodes naturelles.
Nous nous heurtons, pour définir notre ligne, aux mêmes difficultés que nous avons dû surmonter en français, en histoire, en dessin, en musique, et maintenant en calcul. Il y a, parmi le personnel enseignant, une minorité de maîtres qui ont l’avantage d’être particulièrement compétents pour une ou plusieurs spécialités : les uns aiment le français, et savent, sans matériel nouveau, l’enseigner avec compétence et amour; d'autres sont des scientifiques qui s'accommodent avec un incontestable succès des méthodes préconisées par les manuels ; d'autres enfin, possèdent d'exceptionnelles qualités arithmétiques, historiques ou artistiques. Ce sont souvent ces personnalités qui rédigent les cours et les leçons des journaux pédagogiques et qui réalisent les manuels qui restent les outils de base de l’Ecole. Naturellement, ils savent, eux, se servir de ces outils, et il est exact que si tous les éducateurs avaient leurs aptitudes pédagogiques et techniques le problème serait, partiellement au moins, résolu.
Mais ces éducateurs ne sont qu'une infime minorité, disons 1 sur 100 ou 1 sur 1 000. Les autres 99 ou 999 s'évertuent comme ils peuvent, avec des outils et des techniques qu'ils ne parviennent jamais à dominer, ou qu'ils emploient d’une façon mécanique, sans compréhension profonde et donc sans véritable profit pédagogique.
Cet état de fait, sensible pour le français ou le calcul, est particulièrement grave pour ce qui concerne ¡'enseignement des sciences. Les spécialistes en la matière, ceux du moins qui possèdent ces aptitudes exceptionnelles qui ne nous ont qu'effleurés, trouveront suffisantes et valables les directives des manuels et des journaux pédagogiques parce qu’ils seront en mesure d’y ajouter une éminente part du maître pour laquelle nous nous reconnaissons impuissants.
Et pourquoi sommes-nous impuissants ? Parce que, justement, cet enseignement scientifique que nous avons subi tout au cours de notre longue scolarité a, avec nous d’abord, fait totalement faillite et que, en conséquence, nous ne devrions pas en tenter l'usage, forcément identique, avec nos élèves,
Voici, en l'occurrence, ma propre expérience, qui paraît bien être celle de tous ceux qui ont été pris dans l’engrenage scolastique.
L'Ecole primaire du début du siècle, dépourvue alors de manuels, ne m'avait pas même valu un embryon d'enseignement scientifique. Elle a eu au moins l’avantage, pour moi, de ne pas me déformer ni de me décourager devant les notions abstraites de cet enseignement.
Au Cours Complémentaire, les manuels méthodiques ont commencé leurs méfaits, Je « savais», peut-être à la perfection, mon cours de sciences. J’ai tenu par la suite un rang honorable pour cette même discipline à ¡'Ecole Normale. Mais là, j'avais conscience déjà de me trouver dans une impasse, d'apprendre des mots et des définitions, mais de ne pas comprendre, et sentant bien que c’est cette compréhension, qui m'aurait donné le fil d'Ariane qui m'aurait permis de me reconnaître dans le dédale d'une science dont je n'avais pas même entrevu le secret.
Et j'ai eu une bonne note au brevet supérieur.
Or, dans la pratique, et cela depuis ma sortie de l'Ecole Normale, je suis nul en sciences, J’ai oublié radicalement — et je m’en félicite — tous les mots, toutes les démonstrations qui avaient constitué à l'école mon embryon de culture scientifique. Et comme cette école ne s’était pas préoccupée de me donner la compréhension, les fils d'Ariane auxquels j’aurais pu me raccrocher au hasard des difficultés de la vie, il ne me reste rien. Ce n’est pas moi qui vais préparer de l'oxygène, identifier des fleurs et des insectes, monter un moteur électrique... qui marche. Je laisse faire mes élèves à qui je procure les brochures techniques et bientôt tes fiches-guides que nous réalisons pour parer à cette carence.
Et ce qu'il y a de plus grave, c’est que je me sens impuissant à expérimenter et à apprendre, comme si on avait faussé en moi un mécanisme. J’ai perdu définitivement le sens et l’allant scientifiques.
Suis-je un phénomène ? La masse des collègues de ma génération étaient-ils mieux partagés ? J’en serais fort étonné car ils ont souffert comme moi des mêmes tares d'un enseignement détériorant.
Ces choses ont-elles changé radicalement depuis ? Les compendiums et les laboratoires sont mieux fournis aujourd'hui de matériel plus perfectionné et les manuels scolaires ont fait des progrès techniques remarquables.
Hélas ! ce n'est pas la misère de nos laboratoires scientifiques qui nous a valu la malformation dont nous nous plaignons. Le cabinet scientifique de notre Cours Complémentaire était déjà remarquablement riche. Seulement, nous n'avons jamais utilisé nous-mêmes aucun de ces appareils. Le directeur, seul, pouvait s’en servir pour des expériences qui n'étaient que des démonstrations et qui se sont évanouies en nous avec le verbiage qui les accompagnait. Je n’ai malheureusement jamais mis la main à la pâte et c'est de là, évidemment, que vient tout le mal.
Nos manuels de sciences étaient eux-mêmes suffisamment riches et détaillés. Les manuels d'aujourd’hui, quoique plus fleuris, n’en sont pas moins les dignes frères.
Des contacts que j'ai eus depuis, directement ou par lettres, avec de jeunes instituteurs, me montrent que n’est intervenu aucun changement radical dans l’efficience de l’enseignement scientifique, et que nous souffrons tous de la même tare grave qui, au lieu de faire de nous des scientifiques, bouche notre compréhension, notre besoin de recherchas et d'expériences, et nous éloigne de la vraie culture plus indispensable que jamais,
VERBALISME ou EXPÉRIENCE
D'où vient cette tare ?
Certainement du fait qu'on commet, pour cet enseignement, l'erreur centenaire d'une pédagogie de bavards qui, en expliquant le mécanisme d'une bicyclette, prétend nous préparer à rouler sur notre vélo.
Or, rien ne remplace l'expérience. Et c’est parce qu'une scolastique orgueilleuse a cru qu'elle pourrait en faire l’économie qu'elle nous a hissés sur des échafaudages branlants et sans fondations, qui ne sont nullement intégrés à notre vie et à notre devenir, qui ne sont pas nôtres.
Cette affirmation n'est d’ailleurs pas une nouveauté et nous n’en revendiquons point la paternité. Il y a rarement nouveauté dans les constatations que nous faisons et qui sont, depuis des siècles, des lieux communs pédagogiques.
« L'expérience, écrit Claude Bernard, est l'unique source des connaissances humaines. L'esprit n'a en lui que le sentiment d'une relation nécessaire dans les choses, mais il ne peut connaître la forme de cette relation que par l'expérience (1) ».
«Il ne faut point, dit-il encore, enseigner les théories comme des dogmes ou des articles de foi. Par cette croyance exagérée dans les théories, on donnerait une idée fausse de la science, on surchargerait et l'on asservirait l'esprit en lui enlevant sa liberté, en étouffant son originalité, et en lui donnant le goût des systèmes ».
El les Instructions Ministérielles de 1923 dont nous avons eu bien souvent à dire la grande valeur pédagogique, et auxquelles toute notre éducation ne cesse de se référer, avaient bien prévenu le danger dont nous nous plaignons et préconisé des remèdes que nul à ce jour n'a su, ni voulu préparer.
« A l'heure (en 1923) où la puissance économique de notre pays, affaiblie par la guerre, doit reprendre sa plénitude, l'enseignement scientifique, même élémentaire, ne saurait servir seulement à former les esprits ; il doit armer les travailleurs, augmenter le rendement de leur activité productrice.
« Ainsi, tout en conservant partout sa méthode, méthode expérimentale propre à éveiller et à entretenir la curiosité Intellectuelle, doit-il s'adapter aux besoins divers de ses élèves et varier selon leur milieu, selon leur sexe, et selon leur éventuelle profession...
« Dans toutes les écoles, à tous les cours, la méthode employée doit être une méthode fondée sur l'observation et l'expérience. C'est à dessein qu’on a effacé du programme aux CP, CE, CM, le titre : « Sciences physiques et naturelles » pour le remplacer par celle expression : « Leçons de choses en classe et en promenade », expression conservée en sous-titre au CS lui-même. Elle signifie que le livre ne doit jouer dans cet enseignement qu'un rôle secondaire. Elle signifie que le maître n’a pas à faire des cours ; il doit, en classe et en promenade, faire observer et faire expérimenter ».
Et les Instructions Ministérielles du 20 septembre 1938 rappelaient :
« La méthode préconisée par les Instructions de 1923 est également maintenue; elle peut même sembler renforcée par les termes du programme.
« Observer et expérimenter, à partir de phénomènes familiers, de produits matériels, d’opérations courantes, pour aboutir aux connaissances élémentaires indispensables, telle est la méthode, parfois perdue de vue par certains maîtres, dont il ne faut pas s'écarter. Or, les nouveaux programmes rappellent à chaque ligne cette méthode. En insistant sur le fait que les produits à mettre en évidence le seront toujours au moyen d'observations et d'expériences simples.
« Si les nouveaux programmes comportent quelques détails de plus que les précédents, il faut se garder d'y apercevoir une extension véritable de la matière à enseigner, et un accroissement possible de la tâche des enfants et des maîtres. C'est le contraire, exactement, que l'on a voulu ».
On ne saurait mieux dire. Toute notre méthode naturelle de sciences est définie dans ses fondements par les opinions et les Instructions ci-dessus, qui restent toujours en vigueur.
Mais dans la pratique, rien n'a changé depuis trente ans. Les Instructions Ministérielles sont restées lettre morte ; et II ne pouvait pas en être autrement tant qu'on ne remplace pas les outils et les techniques du verbalisme par les outils et la technique de l'observation et de l'expérimentation.
C'est nous qui respectons les Instructions Ministérielles ; c'est la pédagogie traditionnelle, ce sont les manuels scolaires qui en sabotent l'application et qui devraient, de ce fait, être officiellement dénoncés,
Mais comme c'est la grande masse des enseignants qui désobéit aux I. M., on tolère cette anomalie et on partirait volontiers en guerre contre l'Ecole Moderne qui s’applique à faire passer dans la pratique courante de nos classes l'esprit et la forme des I. M.
(1) Introduction à l’étude de la médecine expérimentale.
L’article de C. Freinet que vous venez de lire est extrait de la brochure n° 11-12 de LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE MODERNE consacrée à ¡’ENSEIGNEMENT des SCIENCES.
Cette collection nouvelle est destinée à remplacer et à moderniser la collection maintenant disparue des Brochures d’Education Nouvelle Populaire (B.E.N.P.).
Vous pouvez souscrire en versant 10 NF à
B.P. 282, Cannes (a.-m.) - C.C.P. Marseille 1145-30.
Vous recevrez les brochures paraissant au cours de l’année 1961-62 et vous bénéficierez d'une remise de 40 % sur le prix de vente de chaque brochure. (1,50 NF le N° simple.)