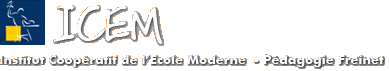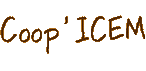La mode est aujourd'hui à l'alphabétisation et à la lutte contre la faim dans le monde, deux maux, fruits du colonialisme et de l'exploitation qui pendant plusieurs siècles ont dominé les rapports entre Etats. Ils sévissent aujourd’hui dans les faits par un manque catastrophique d'éducation et de culture, le mot éducation étant pris dans son sens le plus large, synonyme de formation individuelle, intellectuelle, artistique, sociale, technique, et aussi, comme conséquence, morale et civique de ceux qui doivent pourtant construire un monde où la vie des individus sera digne, efficiente et humaine.
Sur plus de la moitié du globe, les hommes ont faim ; ils ont faim parce qu’ils sont trop pauvres ; ils sont pauvres parce qu’ils ne sont pas en mesure d'agir individuellement et collectivement pour changer avantageusement l'état de fait dont ils souffrent économiquement et politiquement. Ils ne savent pas parce que leurs exploiteurs, loin de les former et de les instruire se sont évertués à tuer en eux toutes velléités de libération. Donnez-leur ces possibilités humaines de réagir : ils sauront alors tirer du milieu où ils vivent le maximum d'avantages et ils ne mourront plus de faim.
C'est parce que nul — et les exploiteurs moins que quiconque — ne cherche à s’attaquer à la vraie cause des maux qu'on se contente de gestes symboliques sans portée véritable.
On expédiera des vivres et des habits aux populations en détresse comme on envoie des bateaux de secours aux hommes qui se noient, mais sans rien changer aux inhumaines conditions de vie qui ont permis cette détresse. Et pour vaincre l'analphabétisme presque encore généralisé dans tant de pays, on enseigne des mots qui donnent l'illusion de la connaissance mais ne font en lien avancer le progrès.
Non pas que nous devions négliger ces premières manifestations d’une évolution internationale prometteuse et bientôt d'une évolution cosmique qui pourrait le devenir. Même si rien de solide ne peut être fait encore contre l'analphabétisme et la faim, le fait qu'on prenne lentement conscience de la gravité et de l'universalité de ces fléaux, le fait qu'on admette que, devant la moitié du monde en danger, nous ne pouvons plus nous contenter de jeter une aumône et de verser un pleur hypocrite, et qu'il ne peut pas y avoir de paix tant que la misère asservit des pays entiers, cette prise de conscience annonce les proches événements que prépare la lente indépendance des peuples.
Cette prise de conscience est incontestablement un premier progrès. Elle peut et doit être logiquement à l’origine d’une vaste action d'humanité pour la liberté et la dignité des peuples en voie de développement,
Il ne suffit pas de constater le mal : il faut nous unir pour le combattre. L'UNESCO engage une campagne contre la faim. Mais il ne faudrait pas qu’on croie que lutter contre la faim c'est publier d'émouvantes photographies d’adultes dégénérés et d’enfants squelettiques, avec à l'appui chiffres et statistiques. Il y a une sorte de satisfaction bourgeoise à savoir qu’on est soi-même à l'abri de tout besoin alors que dans d’immenses pays les habitants ne peuvent pas même satisfaire leur faim et la faim de leurs enfants. On s'habitue généreusement à la misère des autres. Nous avons connu cela lors de la première guerre mondiale quand nous revenions du front, boueux et pouilleux, et que nous tombions comme un reproche vivant au milieu de la masse des gens qui, à l'arrière, s’étaient organisés pour « tenir » douillettement, à l'abri d'une ligne de front où les soldats souffraient et mouraient pour la gloire de rassurants communiqués.
Le monde des bien-pourvus peut fort bien continuer à vivre sans remords en regardant dans les revues ou à la télévision les drames dont pâtit la moitié du monde. Et c'est parce que nous avons conscience de cette réalité que nous ne nous pressons pas d'offrir à nos enfants par une BT sur la faim dans le monde, un spectacle qui n'aurait en définitive aucun enseignement. Une campagne contre l'analphabétisme et la faim n'a de sens et d'utilité que si nous pouvons dire aux enfants et aux hommes nos congénères ce qu'ils doivent faire, ce qu’ils peuvent faire pour que leur inquiétude se traduise par un geste efficient d’humanité.
Mais que faire effectivement?
Il est dépassé le temps où l'Eglise demandait à ses fidèles, les enfants compris, de verser un sou pour la conversion des petits Chinois. Toute quête est hypocritement ridicule parce que le résultat qu'on peut en attendre n'est qu’une goutte d’eau dans un océan d'impuissance et de misère. Demander aux Etats riches de consentir un effort financier hors série en faveur des pays sous-développés? Mais n'allégueront ils pas qu'ils ont fort à faire déjà pour tenir leur budget en équilibre? Et de quel ordre pourrait être en définitive cet effort? Sous quelle forme se manifesterait-il?
Envoyer à ces pays des machines et des tracteurs, les aider à construire des maisons, à filer des habits, à semer et à récolter? Mais qui préparera les hommes et les femmes à se servir intelligemment de ces machines, qui les initiera à une conception de leur monde bâtie non sur la pénurie et la misère, mais sur le travail et la civilisation?
A la base de toute aide à apporter à ces pays, il y a l'effort désintéressé d’instruction et d’éducation pour relever le niveau intellectuel et social des individus. Cette aide est seule susceptible de dépasser l’inutile aumône pour augmenter le potentiel de vie et d’humanité qui seul importe.
L’UNESCO
Dans la chronique de I'Unesco de septembre 1965, la question d’alphabétisation et de culture a été longuement débattue par M. Maheu lui-même et ses collaborateurs.
« Un alphabète est une personne qui a acquis les connaissances et compétences indispensables à l'exercice de toutes les activités où l'alphabétisation est nécessaire pour jouer efficacement un rôle dans son groupe et sa communauté, et dont les résultats atteints en lecture, en écriture et en arithmétique sont tels qu'ils lui permettent de continuer à mettre ces aptitudes au service de son développement propre et du développement de la communauté et de participer activement à la vie de son pays.
Ainsi on se place très nettement dans la perspective d'une alphabétisation qui, loin d'être limitée par un contenu minimum, est conçue comme alphabétisation fonctionnelle, et débouche sur la conception d'une éducation continue ».
«L’éducation, dit M. Maheu, comme l'homme qu'elle a pour objet de façonner et d'instruire, est un tout ; et il faut dire notamment qu’il n'y a pas d'enseignement technique digne de ce nom, j'entends par là un enseignement qui soit autre chose qu'un dressage, sans éducation générale ».
Quels sont les résultats de la campagne engagée?
« Encourageants certes, dit M. Maheu, mais moins satisfaisants que ne semblent l'indiquer les progrès de la scolarisation ». « Il faut, dit encore M. Maheu, renoncer aux activités spectaculaires au profit d'efforts patients auxquels le terme « campagne » ne convient plus, l'alphabétisation devant être une action permanente des organismes responsables ».
Ainsi, alors que nous croyions parler en vain dans un monde où l'aide aux pays sous-développés consiste trop souvent à leur vendre au prix fort des produits dont on n'a plus l'écoulement dans les régions productrices, et où les méthodes préconisées sont jugées non d'après leur rendement mais en fonction du seul rapport commercial, un Congrès mondial des Ministres de l’Education vient de se tenir à Téhéran, du 8 au 19 septembre 1965 sur le thème justement de l'élimination de l’analphabétisme. Sur l'intervention constructive de notre ami Dottrens, de Genève, et de notre Institut Pédagogique National, les dirigeants semblent avoir été amenés à reconsidérer le problème.
•
Nous lisons le compte rendu de ce Congrès dans la revue L’Education Nationale, du 7 octobre :
« Une notion s'est très heureusement dégagée des débats. Elle avait été en particulier développée par M. Dottrens, de la délégation suisse, qui affirmait qu’apprendre à lire ne suffit pas, car savoir lire, c’est comprendre ce qu’on lit. Les conclusions générales précisent que les apprentissages de base (lire, écrire, compter) doivent déboucher non seulement sur des connaissances générales élémentaires, mais sur la préparation du travail, l’augmentation de la productivité, une participation plus grande « la vie civique, une meilleure compréhension du monde environnant, et ultérieurement, s'ouvrir sur le fonds culturel humain ». Pour que cet effort d'éducation soit rentable, il faut éviter de le scolariser mais l'intégrer à la vie des peuples, ce qui sera pour eux la meilleure et la plus indispensable des motivations. « On a souvent remarqué que, pas plus qu'on ne force à boire un cheval qui n'a pas soif, on n’instruit un homme qui n'a pas envie d’apprendre. Il s'agit donc d'abord de faire naître des motivations objectives et subjectives qui pousseront les illettrés à s’instruire ».
Selon quelles méthodes, selon quelles techniques pourra être entreprise cette éducation motivée?
La commission désignée à cet effet, a conclu, et en grande partie sur les suggestions françaises, à la nécessité de ne pas se limiter aux moyens traditionnels et de ne pas attendre que des Etats soient dotés de tout le personnel qualifié nécessaire. Il faut au contraire, faire appel à toutes les bonnes volontés : instituteurs, maîtres bénévoles, éducateurs isolés envoyés dans les familles ou les groupes sociaux.
De même, l'utilisation des techniques nouvelles et en particulier des moyens audiovisuels, est vivement recommandée, avec, au sommet, une équipe de pédagogues hautement qualifiés, et, sur le terrain, la présence humaine d’un maître compétent ou d'un moniteur formé au rôle d'animateur.
Par la suite, l'alphabétisation doit Être entretenue par les distributions régulières de textes imprimés, peu coûteux et par la multiplication d'offices d’édition régionaux, et même de petites imprimeries locales, de construction simple et de prix peu élevé pour assurer la publication d’hebdomadaires ou de textes de lecture dans des régions où la faible diffusion d'une langue ne permet pas la production massive de livres ».
C'est tout le problème de notre pédagogie qui se présente aujourd’hui comme solution pratique à l’urgence de l'éducation et de la culture des enfants, des adolescents et des adultes dans les pays en voie de développement. Nous prêchions jusqu'ici dans le désert parce qu’on croyait possible une autre forme d'alphabétisation pour laquelle on a essayé en vain les moyens audiovisuels, avec cinéma, disques, radio et télévision. On est en train même de préconiser et d'essayer les machines à enseigner du type américain avec laboratoires spécialisés susceptibles de traiter quelques individus à qui on apprendra à grands frais, des techniques arbitrairement isolées du milieu, niais pratiquement sans portée sur la masse du peuple.
Il faut obligatoirement trouver de nouvelles techniques de travail, mêlées à la vie, servant cette vie, susceptibles d’amorcer une formation profonde qui est tout à la lois individuelle, technique et sociale, et dont le Congrès a admis et publié les principes.
Nos solutions
Or, notre méthode pédagogique, servie par les outils et les techniques que nous avons mis au point, semble répondre aux soucis exprimés.
— Par le texte libre, dont il faudra populariser la technique en la préservant de la tentation toujours latente de faire appel à des textes d'auteurs qui ne sont valables que dans les livres, nous puisons dans la vie des individus dans leur milieu, la base même de toute culture.
Nous redonnerons aux individus le sentiment de la valeur et de la dignité de leurs pensées et de leurs actes ; nous les convaincrons de leur maturité, ce qui les entraînera à employer lecture et écriture pour s’exprimer et communiquer avec leurs congénères, comme ils le faisaient jusqu’à ce jour par le seul truchement de la parole. Nous donnerons à leur vie une nouvelle dimension.
Or, le texte libre peut être réalisé partout; il ne réclame pas du maître une culture particulière, sauf de le sauvegarder de la scolastique paralysante qui menace quiconque fait profession d'enseigner.
Mais — et le Congrès de Téhéran l’a bien marqué — il faut à cette forme nouvelle d’expression et de communication une indispensable motivation, qui donne le sentiment que ce nouveau langage ne se produit pas à vide, mais que, comme la parole, il a un but éminent. Or, nous apportons cette motivation par le journal scolaire, post-scolaire, local ou régional.
Le texte libre sera tiré au limographe pour les Centres qui ne peuvent acquérir l’imprimerie. Il sera majestueusement imprimé quand le centre pourra acquérir pour 500 F un matériel d'imprimerie complet, qui permettra le tirage de belles feuilles 13,5 x 21, illustrées, qui incitent les gens à lire et à comprendre (pour une somme supérieure mais non prohibitive, on peut acquérir un matériel permettant le tirage à 300, 500 ou 1 000 ex. de belles pages 21 X 27).
Ces pages ne seront pas des textes savants, traitant de problèmes qui ne se posent pas au niveau où nous nous trouvons, dans un style qui ne serait pas accessible à la niasse. C’est la vie de tous les jours qui s'offrira au lecteur : la vie de la famille, de la case, du village ou du clan, avec les bêtes domestiques ou sauvages, les travaux, les traditions et les croyances, les jeux et les fêtes, les entreprises nouvelles à envisager.
A partir de ce moment, les enfants et les jeunes — les plus vieux aussi — apprendront à lire et à écrire comme ils ont appris à parler, dans le grand livre ouvert de leur vie. L'alphabétisation sera alors, selon le vœu du Directeur de l’Unesco, culture.
— Nous compléterons cette première réalisation par les échanges de journaux et d’imprimés qui donneront une motivation supplémentaire à cette culture de vie.
Quels seraient les avantages d’une telle technique?
— Le matériel simple, inusable, à la portée de tous, ne représenterait qu’une dépense annuelle de quelques francs par élève.
— Textes et imprimés seront nés du milieu. Ils écloront de la vie locale, dans la langue qui lui est propre, première étape de la culture que l’Ecole élargira ensuite vers la langue nationale ou internationale. Nulle autre méthode ne permet l'adaptation à la diversité de langues de tant de pays.
— Cette forme d’éducation ne nécessite pas de locaux spéciaux. Elle peut s’accommoder d’une case aussi bien que de l’ombre des grands arbres l'été.
— Elle est si simple que n'importe quel adulte sensé, moyennement instruit, mais rééduqué, peut y faire face.
— Cette méthode d'apprentissage de la langue par le texte libre, l'imprimé, le limographe, le journal scolaire et la correspondance serait utilement complétée par l'utilisation de nos boîtes et bandes enseignantes qui élargiraient les pistes ouvertes par la Méthode Naturelle. Si quelques-unes de ces bandes pouvaient être produites en série par des centres spécialisés, notre méthode permettrait aux maîtres de réaliser eux-mêmes les bandés adaptées à leur milieu et à leurs élèves.
Sur la base d'une telle méthode, nous verrions très bien alors des individus, des écoles, des collectivités, des organismes sociaux ou culturels prendre en charge l’équipement à leur portée de villages entiers ou de zones plus étendues de pays en voie de développement. Les échanges qui en découleraient noueraient des' relations, même économiques qui donneraient une motivation et un sens à la campagne d'entraide organisée.
Un grand courant culturel s'établirait alors, des écoles et des pays pourvus vers les pays qui, pour avoir trop longtemps souffert de l'exploitation et du colonialisme, restent démunis devant la modernisation technique et culturelle qui pourra alors triompher de la misère et de la faim.
Les temps sont venus de dépasser les voeuix pieux et d’agir. Nous en offrons la possibilité, et c’est pourquoi nous soumettrons ce projet à l’institut Pédagogique National et à l’UNESCO, dans l'espoir qu'il serve la grande œuvre d'entraide internationale, au service de la culture, de l’humanité et de la paix.
C.F.