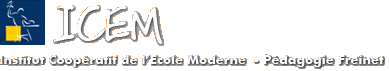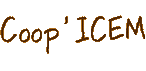Freinet avait tiré la leçon de ce qui était advenu après la mort de Decroly puis de Maria Montessori. Le groupe de leurs disciples s'était figé dans une orthodoxie les privant de toute dynamique et de toute possibilité de renouvellement. Rapidement, l'œuvre de ces pédagogues était entrée dans l'histoire, cessant d'appartenir au présent. Préoccupé par ce risque, Freinet avait constitué un mouvement très pluraliste, sans cartes d'adhérents, dont l'homogénéité se dégageait dans le débat permanent et surtout dans de multiples activités coopératives.
On pouvait, néanmoins, se demander ce que deviendrait, après la mort du fondateur, la cohésion d'un mouvement multiforme où il avait réussi à rassembler ceux qui font encore des expériences, ceux qui ont conservé en eux la mentalité des invincibles bâtisseurs (1).
Vingt ans plus tard, le mouvement de l'École moderne est loin de sortir indemne de la crise actuelle, notamment de la crise de conscience sur les chances d'une réelle transformation sociale. Pourtant l'expérience a montré que le charisme personnel de Freinet n'était pas le seul ciment pouvant réunir des personnalités si diverses, voire parfois contradictoires; les uns, sensibles en premier lieu à la part affective dans l'éducation, d'autres plutôt soucieux d'améliorer les outils et techniques permettant d'autres pratiques, certains donnant priorité à l'engagement social et militant, tous ceux enfin qui trouvèrent là l'occasion d'un épanouissement mutuel des différences.
Mais quelle est donc l'identité d'un mouvement aussi peu monolithique, face aux interpellations extérieures? Après mai 68, certains le trouvaient trop peu marginal pour n'être pas suspect. Pourquoi ce mouvement ne se montrait-il pas plus radical en paroles, mieux accordé aux «révolutions» de la saison? Puis, devant l'entreprise de rénovation pédagogique, en quoi se différenciait-il des nouveaux discours de la hiérarchie officielle? Ensuite, comment se situait-il face au néo-traditionalisme scolaire, porteur d'un élitisme soudain républicain ?
L'identité collective, qui nous fait souvent réagir de façon assez semblable, nous la puisons, certes, dans l'œuvre écrite de Freinet, mais sans doute plus encore dans des pratiques quotidiennes de vie et de mouvement qui ne sont pas le moindre patrimoine que nous ait légué l'auteur de L'éducation du travail. Peut-être n'est-il pas inutile d'approfondir cette spécificité.
Plutôt que de commenter des écrits qui se passent d'exégèse, je voudrais rappeler quelques problèmes-clés sur lesquels bute le système éducatif alors que Freinet leur porte le regard le plus lucide et propose les seules réponses efficientes.
LA DIALECTIQUE DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU
Le créateur de l'École moderne française, le pourfendeur de la scolastique traditionnelle est homme de tradition, comme en témoigne son livre L'éducation du travail. Mais la tradition est pour lui la recherche des invariants fondamentaux, l'enracinement dans le milieu, hors desquels toute culture n'est qu'un placage superficiel; par contre, elle est étrangère à la nostalgie, cette complaisance narcissique si oublieuse des tares du passé.
Quant au modernisme, il marque la volonté d'appropriation de toute découverte, de toute possibilité nouvelle; il n'est pas la séduction par les derniers gadgets, jamais l'acceptation résignée des aliénations engendrées ou aggravées par certains soi-disant progrès.
LA DIALECTIQUE OU GROUPE ET DE LA PERSONNE
Le système scolaire et universitaire français nie toute communauté réelle : chaque membre d'un groupe est soumis à des règles communes mais on refuse les initiatives collectives qui ne passeraient pas par le cadre hiérarchique, seul détenteur de l'autorité formelle (mais dont l'impuissance est la caractéristique dominante).
L'individu, lui, n'est jamais qu'un numéro dans les tableaux de la sélection ou du classement; on ne reconnaît aucune de ses différences. Tout au plus l'enfermera-t-on dans des ensembles ghettos ou dans le face à face avec les machines programmées.
Freinet est le premier, et jusqu'à présent le seul, à avoir opéré la synthèse par le va-et-vient permanent entre la personne et le groupe. Ce qui est personnel peut aller jusqu'à l'intimité, comme en témoigne l'expression libre dans tous les domaines. Mais chaque activité retentit dans le groupe, le dialogue dépasse le tête à tête avec l'éducateur. Le groupe prend une réalité institutionnelle qui elle-même s'ouvre sans cesse dans la confrontation avec d'autres collectivités; le quartier ou le village, les correspondants de toutes sortes.
L'exaltation de la personnalité de chacun n'est jamais individualisme parce que relayée sans cesse par des groupes largement ouverts. La collectivité n'est pas perçue comme oppressante car elle est communauté d'initiative, garante de réussite, jamais carcan ou huis-clos pathogène.
LA DIALECTIQUE DES DIVERSITÉS CULTURELLES
L'école de Jules Ferry a admis comme une évidence que la généralisation de l'instruction devait passer par le nivellement des particularismes régionaux. Encore aujourd'hui, l'antiracisme de nombreux enseignants ne va-t-il pas de pair avec un nationalisme culturel obtus ? Les enfants d'immigrés sont acceptés à condition de se fondre dans les moules inchangés de l'école française. A-t-on réellement dépassé le Nos ancêtres les Gaulois des écoles coloniales ?
Dans un système où les élèves ne doivent que recevoir, il n'y a d'autre perspective pour les non-Français moyens que d'être assimilés, c'est-à-dire de changer d'identité culturelle. Freinet, comprenant que toute démarche culturelle est un échange où tout participant donne et reçoit, permet à chacun d'intervenir dans la communauté avec sa spécificité personnelle, en relation permanente avec les autres.
Face aux démagogues et aux conservateurs (mais que savent-ils conserver?), il permet l'élaboration d'une culture vivante commune qui n'est rien d'autre que le brassage séculaire dont nous sommes issus.
LA LOGIQUE DU COMPAGNONNAGE
Le système scolaire a isolé dans le temps, l'espace et le statut social, une relation didactique dans laquelle des adultes ont pour unique fonction d'enseigner et les jeunes pour seul droit d'étudier.
Or, Freinet a attiré l'attention sur le caractère erroné de la construction scolastique. Les méthodes naturelles ne sont rien d'autre que la prise en compte des processus vrais par lesquels on apprend réellement. Dans la petite enfance, chacun de nous a accompli les apprentissages essentiels, pourtant d'une incomparable complexité, sans préceptorat didactique. Aux niveaux les plus élevés, on n'a pas trouvé de méthode plus efficace pour devenir chercheur, artiste et même homme d'État, que le compagnonnage avec un ou plusieurs maîtres que l'on voit à l'œuvre et non uniquement en position de transmission d'un savoir.
Renouant les deux points extrêmes de tout apprentissage, Freinet souhaite des maîtres qui ne se contentent pas d'enseigner, des maîtres qui n'aient pas la hantise de sortir de leur aire de compé-tence (souvent bien limitée), qui n'aient pas la pudeur de leurs ignorances mais montrent enfin aux jeunes comment se comporte un adulte face à une situation inédite pour lui, enseignement qu'ils ne trouveront dans aucun livre.
On passe alors d'une école où l'on enseigne à une école où l'on s'apprend. Notons le changement de signification du on et !e sens multiple du s' : chacun doit expérimenter par lui-même alors que le groupe s'entre-apprend, un groupe dont le maître fait partie mais où il n'est pas seul à apprendre aux autres et où il continue à apprendre lui-même. On n'a probablement pas mesuré toute la portée de ce retournement éducatif dont nous pouvons pourtant apprécier les effets sur les enfants, notamment ceux qui ont le plus de difficultés, comme sur nous-mêmes.
UNE AUTRE LOGIQUE DE L'ÉVALUATION
Contraints de préparer les jeunes au cursus scolaire et soucieux de montrer que nos résultats formels ne sont pas pires que ceux de l'enseignement traditionnel, nous n'avons pas exploité comme il le mériterait l'apport de Freinet dans ce domaine déterminant.
Car le système en place n'a aucune logique d'évaluation, tout au plus peut-il sélectionner (encore n'y a-t-il pas pires détracteurs de la fiabilité de cette sélection que tes enseignants situés de l'autre côté des barrages). On en est arrivé à dire et à faire n'importe quoi : rétablir un brevet tombé en désuétude, proclamer qu'il faut augmenter sensiblement le nombre de bacheliers sans pouvoir dire à quoi sert le bac (de moins en moins pour entrer d'emblée à l'université).
Face à un contrôle négatif qui ne sélectionne même pas les plus aptes, Freinet propose une évaluation positive, objective et permanente qui donne conscience au jeune de toutes ses potentialités et permette au groupe social de lui confier les responsabilités qu'il sera en mesure d'assumer.
Alors que les diplômes sont globaux, momentanés et pointant acquis définitivement (ce qui est incompatible), le système des brevets et chefs-d'œuvre est une série très diverse d'épreuves partielles, continues et cumulables. Faute d'une expérimentation massive et approfondie, les exemples donnés par Freinet méritent d'être repensés, mais aucun progrès ne sera possible si nous n'étayons pas la crédibilité de notre action éducative sur d'autres critères d'évaluation objective et généralisable.
Car, ne nous y trompons pas, ce qui distingue Freinet de tous les autres pédagogues, ce n'est pas que ses idées soient plus brillantes que telles ou telles autres, c'est que des milliers d'éducateurs puissent montrer qu'elles sont opérationnelles dans des conditions non privilégiées, c'est que son alternative aux manuels scolaires tienne dans une collection documentaire incontestée, la Bibliothèque de travail (B.T.).
Freinet mérite les coups de chapeau des sommités les plus reconnues, mais ce que son œuvre réclame par-dessus tout, c'est de continuer d'être une action du présent et de l'avenir, de s'épanouir dans un nombre grandissant de classes pour le seul intérêt des jeunes et de leurs éducateurs. Et cela relève de notre responsabilité si nous acceptons l'héritage qu'il nous a légué.
(1) Freinet, Les Dits de Mathieu (Dalachaux-Niestlé, p. 135 el 137.