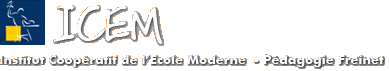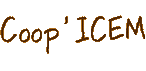MARQUE par son étymologie qui parle d'un instrument d'assujettissement, associé dans des formules — «travail, famille, patrie»... — qui marquent une triste époque, voilà bien un de ces mots dont il est difficile de parler.
Et voilà, dans l'actualité, la chanson de Félix Leclerc qui donne le plus sûr moyen de tuer un homme : le payer sans lui donner de travail... Le nombre des chômeurs augmente : le travail, le «boulot », le «turbin» souvent détesté manque. Dans trois numéros du journal Le Monde, en janvier, le sociologue G. Friedmann tente de faire le point : à plusieurs reprises il souligne l'importante nuance entre le travail choisi et le travail subi.
Dans tout cela, nous parlons encore d'une pédagogie du travail : «Nous apprendrons aux enfants, nous, à être eux-mêmes, intégrés au processus social certes, mais dominés par l'éminente dignité de celui qui sait comprendre, sentir et diriger l'activité essentielle de sa vie ; à se hausser par le travail intelligent A la majesté d'une culture qui est exactement à l'opposé de l'asservissement contemporain. Par le travail régénéré, nous redonnerons à l'individu, au sein de la société, toute sa vertu humaine, première étape vers une réadaptation inéluctable du progrès. Et je ne parle effectivement ni de bonté ni d'amour... Je ne prépare pas une pédagogie de l'amour, mais une pédagogie de l'harmonie individuelle et sociale par la vertu souveraine du travail.., écrivait C. Frein et dans le dernier chapitre de L'Education du Travail.
Serions-nous en retard en accordant encore tant d'importance au travail, notion contestée et ambiguë ? Ou bien serions-nous en avance, à œuvrer pour une société qui appellerait travail autre chose que ce que recouvre le vocable encadré par métro et dodo ?
EN fait, l'important n'est pas de nous situer dans le temps ; nous ne ferons pas l'histoire et si nous arrivions seulement à intervenir par une attitude lucide dans notre fonction d'enseignants dans le sens d'un progrès, nous n'aurions pas perdu notre temps.
Nous sommes en 1976, dans une école qui n'a rien d'idéal, avec des enfants que nous ne choisissons pas. Dans la classe, il y a les enfants et nous — en attendant (et en luttant pour) qu'il y ait dans l'école des enfants et des éducateurs pas forcément séparés par les classes.
Entre les enfants et nous, IL y a ce que nous sommes les UNS et les autres, qu'aucune baguette magique n'effacera subitement et ce que l'institution attend de nous tous : apprendre et enseigner. Dès lors, nous devons choisir : le face à face meublé de paroles et le savoir transmis? Ou bien l'association et le savoir découvert, construit, par les questions et les apports de tous ?
Nous avons choisi la deuxième voie. Nous avons choisi le travail le moins subi possible, nous avons choisi l'activité irrépressible pour qui sait que la vie n'attend que la possibilité de se développer, mue depuis des millénaires par le besoin de comprendre, de prendre sa place et d'aller plus loin.
C 'EST la rentrée et nous ne nous connaissons pas : nous ferons connaissance d'abord et la première fonction du langage, du français, étant la communication, nous nous en servirons ! Notre cadre de vie est là, fait de tables, de matériel divers, de murs nus, etc. Est-ce que dans ce cadre tout est inamovible ? Avec tout ça que peut-on faire ? Laisserons-nous ces murs vides ? Nous choisirons et déjà nous aurons des objectifs communs qui régleront les activités à entreprendre. Et dans la confiance qui s'établit, les questions, les projeta, les besoins deviennent autant de pistes, autant d'occasions de recherches au bout desquelles on ne peut qu'apprendre.
Mais il ne s'agit plus de grammaire en tranches, de mathématiques en chapitre, ni d'éveil de trois à quatre heures. Non, il s'agit de ne pas éteindre la vie. Et nous avons besoin d'un plan de travail : pour ne rien oublier, pour s'organiser et préparer ce dont nous aurons besoin, pour respecter les exigences et les délais que nous nous serons fixés, pour faire le bilan et tenir compte de ce qui aura favorisé ou empêché le travail prévu, pour la suite.
Et ce que nous appelons travail c'est l'ensemble des activités qui découlent des choix que nous avons faits et des nécessités imposées par les programmes par exemple et qui débouche sur des productions vraies, utiles aux individus et à la communauté : que ce soient des peintures aux murs, des étagères où ranger les livres, des exercices pour dominer un calcul, des lettres ou un journal, etc.
Mais les nécessités elles-mêmes seront explicitées et il nous restera des interventions possibles dans le choix des délais et des moyens pour les satisfaire. Ce travail, cet ensemble d'activités, ces productions seront donc en partie choisis, en partie subis (mais en sachant pourquoi), ils feront place à la création, à la curiosité, aux apprentissages, aux découvertes et aux mécanismes, aux travaux sans lesquels une communauté ne peut fonctionner efficacement et aux travaux qu'elle s'impose pour arriver aux buts qu'elle s'est fixés. Mais chaque fois que cela apparaîtra nécessaire cette communauté pourra se réunir et discuter de son travail, non pas sous la seule autorité du maître, mais par le jeu des institutions qu'elle a fait siennes : te conseil de coopérative et le plan de travail par exemple. Comme la liberté, comme la vie communautaire, le sens social et le travail intelligent s'apprennent.
ET, dans le demi-mesure qui nous est imposée aujourd'hui, si ce que permet la micro-société de la classe est différent de ce que l'usine permettra ensuite, si même les conditions de la vie et du travail en classe sont assez loin d'un idéal que nous souhaitons, au moins pourrons-nous dire que les comportements que nous avons tenté d'apprendre ont visé plus loin que l'acceptation passive d'une situation, vers ce qui reste l'objectif de tous les hommes épris de liberté. Nous aurons inscrit notre action dans la problématique évoquée par G. Friedmann dans la troisième partie de son article évoqué plus haut : «Où le travail humain ? L'énigme du XXle siècle» où il écrit : «... comment sans un apport suffisant de travail, même maudit, l'homme pourra-t-il trouver équilibre et bonheur ? Seul un socialisme A visage humain, changeant A la fois les institutions et les hommes sera capable d'y répondre.» Et cela, nous aurons tenté de le faire sur les lieux mêmes de notre engagement social, de notre travail ; à l'école, aussi.
L'EDUCATEUR
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Une pédagogie du travail | 301.42 Ko |