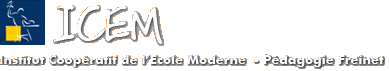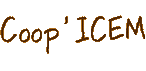Dans : Mouvements › mouvement Freinet ›
Décembre 1959
Mon ami Freinet veut bien me demander de formuler en toute liberté mes réactions de lecteur au premier numéro de Techniques de Vie ; et du même coup quelques suggestions personnelles pour la suite de l'entreprise. Que mes premiers mots soient pour le remercier de cette marque renouvelée d'estime et de confiance.
Je commencerai par l'important article de M. Vuillet qui figure presque en tête de ce numéro, et dirai tout à l'heure sur quels points je me sépare de lui ; mais je veux d'abord marquer mon accord substantiel avec la façon dont il caractérise l'originalité profonde de la démarche de Freinet comme une démarche qui, à l'opposé de celles des théoriciens et des déductifs, est sans cesse remontée « de la pratique à la théorie » : celle d'un inventeur ou d'un metteur au point de techniques pédagogiques, dont Bertrand nous rappellera fort justement (p. 37) que la visée commune est de favoriser au maximum l'expression libre de l'enfant.
Et ici se pose sans doute la première question, la question préjudicielle qui concerne le sens même et la justification de la création d'une nouvelle revue venant s'ajouter à toutes les publications de l'Ecole Moderne Française : ne pourrait-on penser que ces techniques se suffisaient parfaitement à elles- mêmes, et que ces publications antérieures et parmi elles, au premier rang, l'Educateur répondaient à tous les besoins ? Si nous posons la question, c'est pour la trancher aussitôt par la négative ; non que, nous-mêmes philosophe de l'éducation, nous croyions céder ici à la tentation à la fois présomptueuse et naïve de « plaider pour notre saint » ; mais parce que nous sommes convaincus que toute technique pédagogique, fût-elle la meilleure et la plus valable, est toujours menacée de se dégrader et de se mécaniser si elle n'est pas constamment portée et soutenue par la conscience, constamment entretenue, des fins qu'elle est destinée à servir, par une réflexion vivante sur ces fins et sur la relation qui unit à ces fins les techniques utilisées. C'est à cette nécessité que veulent, croyons-nous, et très légitimement répondre Techniques de Vie : au besoin d'un approfondissement philosophique, par les praticiens de l'école Freinet, des principes qui sous-tendent leur pratique. Et par ces « principes » je n'entends pas seulement les principes de leur pédagogie : d'une façon un peu plus spéculative chez l'un, d'une façon plus directement engagée chez l'autre dans les problèmes moraux et spirituels, familiaux, professionnels et politiques de l'instituteur, C. Combet et Le Bohec ont bien montré que la pédagogie ne peut être isolée, sinon par une vaine abstraction, de toute une philosophie de l'existence,et que celle-ci se trouve toujours, plus ou moins consciemment, impliquée dans les options proprement pédagogiques des enseignants, et surtout de ceux qui se rangent au parti des novateurs. Prendre mieux conscience de la philosophie qui soutient leur effort quotidien dans leur classe, confronter leurs idéaux de vie, éclairer et consolider leur foi commune en ces idéaux dans et par un échange fraternel, n'est-ce pas une des tâches les plus valables que puissent se proposer des éducateurs soucieux de devenir, chaque jour, de meilleurs éducateurs ? Et cette tâche n'est-elle pas la plus haute, et l'une des plus essentielles que puisse s'assigner Techniques de Vie ? Les deux articles que nous venons de citer nous paraissent, dans cette direction, riches des plus belles promesses.
Il nous faut pourtant redescendre à présent aux problèmes spécifiques de l'éducation, puisque c'est à eux que notre revue entend essentiellement se consacrer. Elle veut s'y consacrer non pas au niveau de la pratique journalière, mais dans une perspective de large réflexion qu'elle définit elle-même, encore, comme une perspective « philosophique » : elle croit expliquer son titre (qui n'est peut-être pas, il faut l'avouer, parfaitement limpide de « Techniques de Vie » en lui donnant pour sous-titre — plus exactement pour surtitre puisque ces mots figurent en tête sur la couverture — « les fondements philosophiques des Techniques Freinet ». C'est ici, à mon sens, que le malentendu risque de commencer.
Qu'entend-on en effet par ces « fondements philosophiques des Techniques Freinet » ? Veut-on dire qu'elles reposent sur une philosophie de l'éducation qui lui soit propre, sur une philosophie entièrement originale, qui, comme le dit Vuillet (p. 14) serait restée jusqu'ici « implicite » et que ce serait la tâche même de la nouvelle revue d'expliciter et d'élaborer. Ce paraît bien être aussi le point de vue de Combet dont l'article représente un effort dans cette direction, aussi intéressant à notre sens que discutable ; tel paraît être le point de vue de Freinet lui-même, puisqu'il estime que « nous aurons à rebâtir notre nouvelle psychologie, notre nouvelle philosophie, bases d'une pédagogie qui s'est déjà renouvelée expérimentalement » (p. 33), et qu'en particulier la découverte du « processus de tâtonnement expérimental » constitue un « retournement décisif» qui à la fois exige et permet cette reconstruction radicale (p. 36). Lorsque au contraire Ferrière voit l'essentiel de la « philosophie de l'Ecole Moderne » dans la volonté — en opposition à « l'école traditionnelle » — de « ne pas tuer chez l'enfant le vouloir savoir, d'apprendre à chaque enfant à vivre, à agir, à croître» (p. 1), ou encore lorsque Bertrand précise cette volonté comme étant celle d'inciter et d'encourager sans cesse l'enfant à « dire, raconter et exprimer, par le dessin, par les couleurs, par la parole, comme par le chant et la danse, ce qu'il ressent» (p. 37), il est clair que les objectifs ainsi définis — dont il est bien exact qu'ils enveloppent toute une « philosophie » de l'éducation et de la culture — ne sont nullement propres à l'Ecole Moderne, mais lui sont strictement communs avec tout ce que l'on appelle depuis quelque cinquante ans le mouvement d'éducation nouvelle, d'où sont sorties bien d'autres didactiques, bien d'autres techniques que celle de l'Ecole Moderne. De ceci d'ailleurs Freinet a au fond tellement conscience qu'il n'hésite pas à écrire, dans un autre article, et peut-être cette fois aussi avec quelque exagération — mais c'est une exagération dans le sens opposé, une exagération dans l'humilité : « Nous sommes les continuateurs de Decroly à qui nous devons tout » (p. 4).
Voici donc la première question que je pose : se propose-t-on de fonder une nouvelle philosophie de l'éducation ou, simplement et beaucoup plus modestement, d'approfondir la « philosophie de l'éducation nouvelle », considérée comme justification et support des techniques Freinet, et dans ses rapports à ces techniques ? Tout le sort de la nouvelle entreprise dans laquelle vient de s'engager Freinet, et pour laquelle il est inutile de dire ma sympathie, dépend de la réponse qui sera finalement donnée à cette question. Ma propre réponse se lit, je pense, à travers les lignes : c'est d'ailleurs celle que suggère mon ami Robert Dottrens dans sa contribution au premier numéro de la revue (pp. 21-23) : le sens de son article est, si je ne m'abuse, d'inviter l'Ecole Moderne à ne pas se couper du grand mouvement de rénovation pédagogique dont elle est un aspect et un moment, à ne renier ni ses origines ni ses parentés, à refuser de s'isoler dans je ne sais quel séparatisme et quel particularisme orgueilleux : il y va, selon nous, de son avenir même.
Ma seconde question, d'ailleurs étroitement liée à la première, sera celle-ci : veut-on vraiment que le nouvel organe soit, comme le demande Freinet (p. 29), un organe de « discussion », et même de libre discussion sur les « fondements philosophiques des Techniques Freinet » ? S'il en est bien ainsi, cela signifie et implique qu'il ne saurait y avoir de « tabou », que tout doit pouvoir être soumis à la discussion et mis en question... jusqu'à ces techniques elles-mêmes ; et qu'il doit s'agir moins de chanter leurs « succès » et leurs « vertus » ainsi que le fait Freinet dans la même page que de réfléchir en toute liberté sur les services qu'elles ont rendu, sur tout ce qu'il est légitime d'en attendre et d'en espérer... et éventuellement aussi sur leurs limites ou leurs lacunes. Il me semble y avoir sur ce point aussi une équivoque qu'il est nécessaire, et même urgent de dissiper. Je voudrais en particulier que fût sérieusement discutée la question de savoir si la philosophie de l'école traditionnelle, qui n'est assurément pas celle de l'école Freinet, n'a pas aussi ses valeurs, qu'il faudrait essayer d'intégrer et non de condamner et de rejeter en bloc ; et si les techniques Freinet constituent bien, toujours et dans tous les cas, l'outil suffisant, et le plus efficace, pour les servir et les promouvoir : c'est, en substance, la question que j'ai soulevée dans un récent article de l'Education Nationale (8 octobre 1959).
Cet article m'a valu une abondante correspondance, venue de bien des villes et des villages de France ; je remercie ici, n'ayant pu encore leur répondre à tous individuellement, ceux qui ont bien voulu me faire part des réflexions qu'il leur avait suggérées.
Que l'on m'entende bien : je ne demande pas que l'on m'accorde que les questions posées par moi aient été bien posées ; je demande seulement que toutes les questions puissent être posées, et que l'on ne se flatte pas de les avoir toutes résolues.
Un dernier mot : nul ne souhaite plus sincèrement, plus ardemment que moi le succès de Techniques de Vie ; je n'ai pas pensé pouvoir apporter plus utilement ma modeste contribution à ce succès qu'en m'exprimant ici avec la franchise parfois un peu rude d'un ami.
****
Les problèmes bien posés, nous dit-on souvent, sont déjà partiellement résolus. M. Bloch nous permet aujourd'hui, par ses pertinentes observations de mieux situer notre effort.
Et je réponds tout de suite aux deux questions de M. Bloch.
Je laisse aux philosophes qui voudront bien participer à nos discussions le souci de mieux préciser le sens de ce mot philosophie. Je ne vais pas, personnellement, en chercher ta définition dans un dictionnaire ou en considérer le sens selon l'œuvre de tel ou tel de nos maîtres.
Quand, avec Le Bohec, nous avons extériorisé ce besoin de recherches nous avons procédé par éliminations. Il ne s'agissait pas pour nous de préciser les origines ou fondements techniques et sociaux de notre pédagogie — ce que nous nous appliquons à faire dans notre revue l'Educateur. Nous voulions discuter des fondements psychologiques certes mais il n'en restait pas moins une zone de notre curiosité qui n'aurait pas été satisfaite, celle des incidences possibles de nos travaux sur une infinité d'éléments vitaux qui débordent tes conceptions pédagogiques et psychologiques habituelles pour atteindre jusqu'à la conception de la vie, de l'intelligence, de l'effort, de l'affectivité, de l'humanité et jusqu'à cette notion de bonheur que vont nous poser Bertrand et Le Bohec,
Nous avons pensé que le mot « philosophie » embrassait le mieux ces multiples perspectives.
Dans ce domaine aussi nous sommes partis sans aucun apriorisme. Et surtout, nous n'avons nullement la prétention de fonder une nouvelle philosophie de l'éducation, et encore moins d'approfondir la philosophie d'une éducation nouvelle dont nous ne faisons point notre drapeau, bien que nous n'en ignorions point les conquêtes
Notre requête est toute simple et naturelle. Nous avons découvert et mis en usage dans nos classes de nouveaux outils de travail qui affectent tout particulièrement le comportement scolaire et extrascolaire des élèves et des éducateurs. Tout comme l'invention et la généralisation de l'automobile, de la radio et de la télévision affectent d'une façon parfois décisive le comportement des individus, enfants et adultes qui y sont soumis. Cette influence, en bien ou en mal, mais certaine, vaut d'être étudiée objectivement, scientifiquement si possible, afin de corriger les erreurs éventuelles de technique et d'orientation.
Nous n'avons nullement l'intention de nous couper des mouvements d'éducation nouvelle, ni même des méthodes traditionnelles dont nous restons, par la force des choses, si gravement tributaires, ou du moins la coupure se fera malgré nous, plus ou moins radicale, comme elle s'est faite entre tes transports actuels en automobile et les anciens voyages à chars à bancs. Il y a tout à la fois d'ailleurs coupure et continuité. Mate il n'est pas niable que des éléments nouveaux jouent dont nous ne pouvons ignorer la portée.
Nous voudrions savoir les résonnances profondes de nos techniques sur la vie scolaire et sur notre vie tout court... C'est cela que nous appelons l’aspect philosophique du problème. Qu'on nous excuse l'imprécision possible de cette appellation.
Notre réponse sera plus facile et plus nette à la deuxième question de M. Bloch qui nous apparaît d'ailleurs comme la suite des observations ci-dessus.
Bien sûr, ce sont nos techniques elles-mêmes qui peuvent être remises en question. Nous les remettons d'ailleurs sans cesse en question nous-mêmes. Nous ne nous nourrissons pas de théories mais de technique de travail. Si, à l'usage, une de nos techniques ne répond pas à nos besoins nous ne risquons' pas de ta maintenir artificiellement par explications ou justifications,
Si même quelques-uns d'entre nous restent attachés par sentimentalisme à l'une de ces techniques condamnées par la pratique, nous ne nous faisons pas d'illusion : ta masse des éducateurs — car si nos techniques ont vraiment les vertus que nous leur croyons elles seront employées un jour prochain dans toutes les écoles — ta masse des éducateurs n'emploiera nos techniques* que si, tout compte fait, elles s'avèrent supérieures aux méthodes de naguère. Nous sommes bien à la recherche des meilleurs outils, des meilleures techniques de travail, que ce soient les nôtres ou d'autres. Nous n'avons en l'occurrence aucun amour propre d'auteur.
Nous n'avons jamais prétendu que nos techniques soient parfaites et suffisantes en toutes circonstances, ni qu'il ne puisse rien y avoir de bon dans les méthodes du passé. Nous disons seulement, à l'expérience — et une expérience qui s'étend à des dizaines de milliers d'éducateurs — qu'elles nous paraissent supérieures aux méthodes traditionnelles. Et cette supériorité est une raison suffisante pour la généralisation de leur emploi.
Il ne saurait y avoir d'Ecole Moderne sans une recherche et une adaptation permanentes des méthodes et des techniques aux nécessités d'une vie plus mouvante que jamais.
C'est cette recherche et cette adaptation que nous voudrions promouvoir avec l'appui de tous les éducateurs qui ont conscience des impératifs radicaux de notre époque.
Célestin Freinet
Auteur :