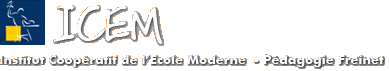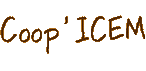Par Michel Mulat le 25/06/15 - 10:52
Dans :
Situation de l'information télévisée.
« La télé ment, tout le monde le dit, papa, mais aussi les profs, les copains dans la cour. »
Ce qui m'intéresse c'est avant tout la part que nous prenons, nous enseignants, dans cette attitude de rejet. Les critiques de l'info-télé se sont multipliées. « Arrêt sur image » - qui s'est toujours plus intéressé au discours qu'à l'image qui l'illustrait -, a fait des émules. Même Canal plus, évitant toujours le retour sur soi, fait le procès permanent de ses concurrents télévisés.
Les enjeux sont financiers avant tout, en gagnant des spectateurs on prend du poids pour négocier sa part auprès de financeurs publics ou privés, et on peut augmenter le coût de la seconde d'écran vendue pour de la publicité.
Alors la pression est faite sur le personnel pour que soit délivrée, le plus rapidement possible, une information crédible, sachant que toute erreur sera vite oubliée. Les équipes de reportage traditionnelles comportant un cadreur, un preneur de son, un journaliste (et souvent un gestionnaire), sont remplacées par des JRI (journaliste reporter indépendant ayant statut d'intermittent du spectacle), une seule personne assurant tous les métiers, avec plus ou moins de compétence, un salaire réduit et une grande mobilité. Le journaliste n'est plus alors qu'un commentateur placé devant des images incrustées qui font croire qu'il est sur place, images que souvent il découvre en parlant, sur le petit moniteur placé devant lui. Le montage qui était effectué par un ou plusieurs monteurs en présence d'un réalisateur, est assuré par un monteur seul, disposant d'une banque inépuisable d'images d'archives, de bruitages et de logiciels de trucage permettant de les modifier dans des temps record. De plus en plus, Final cut le permettant, le montage (comme le trucage) est effectué par le JRI lui-même sur son ordinateur portable, également chargé de banques d'images et de sons, correspondant globalement au thème de son reportage. Les studios se contentent alors de conformer, de mettre les images aux normes imposées pour la transmission, et de compresser les sons.
L'économie ainsi conçue fait que les reportages ont perdu en qualité cinématographique. Pas grave puisqu'on fait appel aux gens de la rue. Mais pour récupérer des films amateurs, il faut appâter en dégradant ses propres images pour qu'elles ressemblent à celles d'un appareil photo numérique de basse qualité. Stratégie utilisée en Côte d'Ivoire pour prouver, avec la complicité de comédiens, que Gbagbo assassine des manifestants en pleine rue. Par contre, un amateur ne peut pas délivrer, pour raisons syndicales, d'images meilleures que celles d'un professionnel : on va faire bouger artificiellement, avec des logiciels de trucage ses propres images et « gratter » le son.
Le même écran présentant, dans le même espace familial, les séries américaines violentes et les reportages sur la Syrie, transforme tout en fiction : les morts sont vécus, par nous tous, d'abord comme les figurants d'un « film d'action ». Ce n'est pas l'augmentation de la violence qui pose problème, mais le statut de l'image inscrite dans une narration, avec ses règles de gestion de la temporalité en particulier.
Sachant cela, pouvons-nous nous contenter de dire à nos élèves : « ne regardez pas la télé », « la violence n'est pas pour vous », « la télé ne dit pas toute la vérité ». Nous ne pouvons pas nous contenter de demander à un groupe de regarder une information pour en présenter la critique en classe, sans que ne soient projetées les images correspondantes. Le discours sera conforme à l'attente du maître : « c'est nul ! C'est faux ! » Et puis après ?
C'est dans cet "après" qu'est le plus grave à mes yeux, la perte de confiance menant à des attitudes plus dangereuses encore. Ce faisant, ayons conscience du fait que nous précipitons nos élèves dans les mains de manipulateurs plus dangereux encore, ceux qui utilisent internet, ceux qui y perfusent la théorie du complot.
L'info télé est fugitive, comme la fiction du soir. Elle passe sans qu'on puisse l'arrêter. Elle correspond toujours à un « on a vu », un passé. Cliquer sur le web c'est regrouper pour une analyse comparée, dans le présent, pausée donc. Je peux avoir sur mon écran 50 sites présentant des vues commentées sur un seul des attentats de la journée du 7 janvier à Paris. 50 sites pour écraser Pujadas! « Une nouvelle vidéo montre les frères Kouachi après l'attentat », présentée par 10 sites différents avec variantes de montage. « La vidéo amateur était falsifiée » ose un quidam, et 30 autres vont confirmer en apportant la preuve irréfutable, et cela aboutit à « l'incohérente cavale... » sur un site d'extrême droite.
Toute personne disposant d'un téléphone portable sait filmer et donc commenter tout film.
Alors nos élèves sont convaincus qu'ils savent analyser des images puisqu'ils les critiquent. Et ils les critiquent en comparant de nombreuses informations. Mais ce dont ils n'ont pas conscience c'est que ces informations sont manipulées par des politiques, des sectes et des illuminés. Ils ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas le nombre de confirmations qui prouvent la vérité d'un dire.
Que faire dans ma classe ?
Commencer par être conscient soi-même de tout ce qui a été dit ci-dessus, et avoir pris le temps de le détecter en regardant différemment sa télévision et en questionnant le web de manière ciblée.
Et puis Paul Le Bohec disait qu'une fois être passés par l'information, la seconde étape indispensable c'est de FAIRE, en imitant d'abord, en critiquant ensuite. Faire des images d'information, simples, au plus près de ce qu'on veut dire et montrer. Faire des images manipulant l'information, pour comprendre les ressorts de la manipulation. Ce n'est qu'à partir de là qu'on saura analyser l'information de la télévision et opérer de réelles comparaisons entre les sites sur internet.
Se mettre un sac sur la tête, et encore plus mettre un sac sur la tête de nos jeunes, aura des conséquences de plus en plus dramatiques. Pour moi, c'est plus important et plus urgent que les apprentissages qu'on nous dit fondamentaux. On n'a pas besoin de savoir lire un texte pour apprendre à lire une image.
Michel Mulat