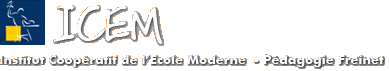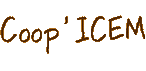Dans : Principes pédagogiques ›
Février 1979
JEU DRAMATIQUE...
AU-DELA DE L'IMPROVISATION, BEAUCOUP DE QUESTIONS
Jeu dramatique ? Jeu certes, qui, non seulement permet de faire 'Jouer" toutes nos possibilités, nos ressources, mais nous conduit à l'exigence. Et la question se pose, engagés dans ce vrai travail au même titre que nos élèves, sommes-nous n'importe quel participant ? Quand aidons-nous et quand manipulons-nous ? comment nous en rendre compte, seul dans notre classe ? Comment donner assez de force au groupe d'élèves pour qu'il puisse être le régulateur de notre pouvoir ?
LE CADRE
Une classe de quatrième, 21 élèves, tous d'origine italienne, "faibles" scolairement, sauf deux ou trois exceptions. Je connaissais certains d'entre eux l'année précédente, dans le cadre d'activités, jeu dramatique en particulier, car nous travaillions beaucoup ensemble, leur professeur et moi. Dès la rentrée, ils réclament donc une reprise du "théâtre".
Deux lieux :
le "club théâtre", une heure par semaine en dehors des heures normales de classe. 14 y sont venus toute l'année très régulièrement et à la fin toute la classe s'y retrouvait.
- l'heure de classe du jeudi où nous pouvons officiellement utiliser deux salles, et pendant laquelle se font des travaux en ateliers, théâtre entre autres.
Au premier trimestre, nous faisons uniquement des jeux (exercices corporels, vocaux, de situation dans l'espace, de sensations, scènes improvisées à partir d'attitudes, de textes ou d'idées des élèves ). Mais le but de tous est de réaliser un spectacle, et beaucoup veulent un texte déjà écrit pour changer de ce qu'ils ont fait l'année précédente. Finalement entre diverses propositions, ils gardent deux scènes très courtes de "Grand'Peur et Misère du IIIème Reich" de Brecht, mettant en scène des jeunes de leur âge. Puis l'idée naît qu'il faudrait, en contrepartie, montrer la vie des jeunes d'aujourd'hui. Quatre brèves scènes seront mises au point et le tout unifié pour former un spectacle d'une vingtaine de minutes, joué 5 ou 6 fois en juin.
TEXTES D' AUTEUR
Plus lointains au départ, ils nous ont semblé permettre un travail très enrichissant qui a apporté une réussite très gratifiante à ceux qui l'ont mené jusqu'au bout. Plusieurs axes pour ce travail :
- reconstruction très précise de chaque personnage (même des rôles sans parole ), chacun apportant sa vision des choses, le regard de la classe permettant ainsi d'éviter les incompatibilités avec le texte et éclairant chacun.
- travail sur "l'environnement" : par exemple, pour ces deux scènes, connaissance de l'hitlérisme, en relation avec le professeur d'histoire et surtout :
- comme chaque phrase écrite doit sembler naturelle dans la bouche de celui qui la prononce, il faut trouver (en jouant bien sûr, pas intellectuellement) tout ce qui se passe en actions ou dans la tête du personnage entre deux répliques et qui justifie la parole suivante. Un détail qui peut servir d'exemple: c'est parce que le papier qu'elle a mis à l'intérieur de ses chaussures la gêne quand elle bouge le pied que la fille parle à sa mère des souliers du bureau de la bienfaisance.
Il faut donc jouer à fond toutes ces situations intermédiaires et ne jamais rompre la continuité de la scène.
- ces situations peuvent ressembler directement beaucoup à celles qu'ils vivent ; à ce moment-là, pas de problème.
Sinon il faut que chacun les retraduise dans sa propre expérience, afin de s'appuyer, en jouant, sur des sensations connues réactualisées.
Sinon il faut que chacun les retraduise dans sa propre expérience, afin de s'appuyer, en jouant, sur des sensations connues réactualisées.
exemple : chacun a dû retrouver (sans le formuler pour les autres) des occasions où il a été effrayé par quelqu'un, ou ce dont il a peur dans la vie, et s'en servir pour jouer l'entrée du chef des jeunesses hitlériennes.
Apports de ce genre de travail :
- entrer en contact de façon profonde, active et à "égalité", avec d'autres expériences, d'autres façons de voir, élargir donc son horizon.
- un grand enrichissement de l'expression personnelle.
Rosanna qui avait redoublé à cause du français a fait d'énormes progrès dans ses textes après avoir beaucoup travaillé son rôle dans une scène de Brecht : d'une part elle avait acquis une exigence de "logique interne", de continuité, d'autre part elle savait utiliser son expérience personnelle pour "nourrir" d'autres situations.
Difficultés :
- trouver des textes (de théâtre ou pouvant être mis en jeu) rejoignant les préoccupations profondes de la classe. Ne pourrait-on, à l'intérieur de l'ICEM, échanger des idées à ce propos ?
- aider les élèves, soutenir leur "moral", leur volonté, jusqu'au moment où la réussite est telle qu'elle devient un moteur suffisant, avec, bien sûr, le risque d'échouer si le texte est mal choisi et si l'élève n'arrive pas à faire se rencontrer le texte et son vécu personnel.
LES SCÈNES INVENTÉES
Plus directement motivantes au départ, elles ont finalement demandé beaucoup plus de travail.
Au départ, pendant une heure, on a noté toutes leurs idées sur ce qu'il y avait de caractéristique à montrer dans la vie des jeunes aujourd'hui dans leur milieu, des anecdotes, des récits personnels.
Puis deux groupes se sont formés et, à partir d'un ou deux de ces éléments, ont bâti un scénario, en le jouant au fur et à mesure des idées, nombreuses. Puis on a retravaillé ce matériau.
Difficultés rencontrées :
Ne pas faire passer un autre message que celui qu'on veut faire passer. Le fait qu'il y avait toujours un groupe spectateur aidait à souligner certaines erreurs. Au fur et à mesure que chacun était plus engagé dans le travail, nous avons dû avoir recours à d'autres regards "extérieurs".
La rencontre nationale à Avignon début mai, bien que la classe ait refusé certaines critiques, a accéléré le processus.
- Très longtemps, il a été impossible de sortir de la continuelle improvisation, retransformée à chaque fois, suivant le caractère et les moyens d'expression de chacun, bref impossible à présenter en spectacle.
Finalement, en particulier à la rencontre d' Avignon, ils se sont rendu compte, en tant que spectateurs, de "longueurs", devenant vite pénibles, et se sont ralliés à mon goût personnel : les scènes ont été reprises avec l'aide de volontaires non acteurs pour arriver à un texte ne comportant que ce qui était important pour le sens de la scène, aussi complet et nuancé que possible, dit le plus simplement possible. On a abouti à un texte écrit qui a été appris par les acteurs qui, très vite, l'ont travaillé de la même manière que ceux de Brecht, étant donné qu'ils en avaient eux-mêmes apporté toute la matière.
- Une autre difficulté n'a pas toujours été résolue. présenter un spectacle c'est prendre parti, et ce n'est pas toujours évident.
Un exemple parmi beaucoup d'autres : dans une scène un jeune "voyou" agressait assez violemment une commère qui s'était permis de moucharder à ses parents. Au départ, dans l'esprit de la plupart, il avait entièrement raison, l'escalade de la violence leur semblant aller de soi.
Dans le même ordre d'idées, certains avaient écrit un "roman" où une classe, pour se venger d'un chef d'établissement, l'enlevait, car il punissait sévèrement pour de petites fautes. Mais certains, loin de s'arrêter à une leçon, à une mise en garde, torturaient et mettaient à mort ce directeur dans les pires conditions. Quand je leur ai fait remarquer que la classe avait adopté en pire la même démarche que le chef d'établissement, une grosse partie de la classe était en fait d'accord, mais quelques-uns non. Quand une adulte leur a dit que le jeune "voyou" avait les mêmes méthodes que le chef de la jeunesse hitlérienne, quelques-uns ont même refusé la discussion sur ce point. Pour le spectacle lui-même, la majorité a tranché, imposé un point de vue plus modéré. Mais je sais que Jean-Pierre, et un peu moins quelques autres, non seulement sont restés sur leur position (pour se "défendre", toute violence est bonne) mais l'ont renforcée en l'exprimant. Le prof ne fait pas toujours le poids.
QUESTIONS
- Je trouve que le jeu dramatique est un moyen riche pour "prendre en compte" l'environnement culturel et social et permettre en même temps au jeune de dépasser ses conditionnements (éditorial Éduc. nov. 77)
Mais je me demande par quel angle aborder la réalité vécue par les jeunes pour leur donner le plus de chances possibles de la dominer un peu, de progresser dans leur réflexion, quels moyens utiliser. Abordez-vous tous les problèmes de front ?
- Le goût de l'énorme majorité de la classe rejoignant le mien je participe chaque semaine à un groupe d'enseignants s'entraidant chaque semaine à l'expression corporelle, vocale, au "théâtre", grâce à une animatrice comédienne, ancienne institutrice, qui vient aussi nous aider dans les classes), ce travail a pris une place très importante pour tous cette année. La classe a intégré les exigences dans ce travail, cherchant toujours d'elle-même à s'améliorer. Mais je n'ai pu le faire que parce que j'étais engagée moi-même dans une recherche similaire. Je ne suis pas encore prête à le faire dans d'autres domaines.
- D'autre part dans tout "travail" quand on veut dépasser le premier jet, la "part du maître" prend de l'importance. Mais où s'arrête le respect du jeune et où commence la manipulation ? Comme il n'y a pas de réponse générale, je ne vois d'aide possible que dans le travail à plusieurs, mais à condition que les autres puissent voir chacun au travail. C'est si facile, en discutant, de raconter la réalité comme on voudrait qu'elle soit concrètement; d'autre part, dans une région où la majorité des enseignants se veut "de passage", le travail à plusieurs n'est pas toujours facile à réaliser. Les rencontres comme celles d'Avignon sont bien utiles, mais trop courtes pour qu'on puisse vraiment échanger entre enseignants pendant la rencontre elle-même.
Je termine par une proposition d'un autre ordre : j'ai trouvé très intéressantes les fiches de "jeux de groupes" proposées par Christian Poslaniec . Je trouve qu'on devrait constituer dans le même genre un fichier d'exercices de "jeu dramatique" à partir de ceux que chacun utilise pour travailler la voix, le corps, l'espace, les sensations, l'imagination etc...
Qui serait volontaire aussi pour réaliser ce travail ?
Il y aurait encore à aborder par exemple la variété des moyens d'expression des "formes" de jeu mais ...
J'attends beaucoup les critiques et surtout les expériences, dans le même sens ou opposées.
Isabelle BECK - (Moselle)
Auteur :