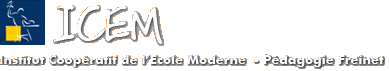Par Claude Beaunis le 02/09/11 - 10:50
Bertrand Daunay
Professeur à l’université Charles-de-Gaulle – Lille 3
Directeur de Théodile-CIREL
Je me propose d’aborder la question de l’enfant-auteur du point de vue de la didactique de la littérature. C’est là un point de vue particulier sur la question de l’enfant-auteur, mais je pense non seulement qu’il est assez pertinent parce qu’il est dans tous les esprits, quand on parle de l’« auteur », mais aussi parce que ce qui se dit sur l’auteur littéraire peut avoir des résonances avec la question plus générale de l’auteur…
Dans un premier temps, je définirai la manière dont la didactique du français peut penser la question, en identifiant les contraintes qui sont les siennes dans l’appréhension de cette question, ce qui m’amènera à interroger les termes enfant, élève, auteur. Je montrerai ensuite que la question de l’enfant-auteur a été traitée en didactique du français, dans ce cadre et dans cet espace de questionnement, par des propositions – théoriques et pratiques – de diverses natures, depuis plusieurs dizaines d’années, par l’investigation de trois dimensions particulières : le devenir de l’« enfant-créateur » ; les relations avec l’objet d’enseignement « littérature » ; l’institution d’une « communauté » d’auteurs-lecteurs.
1. Une inflexion didactique à la problématique de l’enfant-auteur
La question que la didactique peut poser est celle-ci : comment l’élève, autrement dit l’enfant en situation scolaire, devient-il auteur ?
On le voit, par cette reformulation de la question, la première inflexion qu’apporte la didactique à la question de l’enfant-auteur est celle qui consiste à penser l’enfant comme scolarisé, comme élève donc, en interrogeant à la fois les relations complexes entre le scolaire et l’extrascolaire1 et les conditions proprement scolaires de l’autorisation de l’enfant-élève. Avec une question qui est centrale et qui guidera certaines de mes réflexions : finalement, que reste-t-il de l’enfant quand il devient élève, et particulièrement dans le cas qui nous occupe de l’enfant-auteur ? Par les mots que j’utilise ici, j’identifie deux espaces (l’école et le dehors) et es dimensions du sujet (l’enfant, l’élève) qui ne sont pas en opposition, mais qui font apparaître des tensions, tensions que la méthode naturelle a précisément identifiées et pensées, et qui font encore l’objet de débats sociaux fréquents2 :
– la réussite des apprentissages est supposée conditionnée, selon les discours, soit par une coupure soit par une continuité entre l’école et le « dehors », autrement dit entre l’élève et l’enfant : d’un côté, on suppose un apprentissage efficace en milieu scolaire s’il rompt avec les pratiques dites ordinaires (notamment les pratiques culturelles), avec le rapport au langage institué dans la famille, avec les savoirs ordinaires que les formes sociales non scolaires transmettent, avec les formes mêmes de transmission qui favoriseraient le zapping, l’efficacité immédiate, etc. ; de l’autre côté, on suppose précisément que le sujet scolaire ne peut advenir pleinement que si les médiations scolaires avec la culture extrascolaire permettent à l’enfant de se penser comme élève, de se voir en quelque sorte « identifié » par l’école ; les deux positions sont parfaitement défendables, toutes légitimées aussi bien par le bon sens que par des traditions pédagogiques, mais elles n’ont de sens à mes yeux que si elles ne se défendent pas simplement dans une opposition à la position inverse ;
– les apprentissages scolaires et/ou disciplinaires sont posés soit comme spécifiques et indépendants des transferts possibles hors de l’école, soit comme indissolublement liés à la finalité de leur efficacité en situation non scolaire : d’un côté on identifie la spécificité de la « forme scolaire », non dans le sens négatif que prend l’expression dans son berceau sociologique initial, mais dans le sens positif qui identifie dans cette forme la possibilité d’une formation spécifique, notamment dans le cadre des disciplines scolaires, formelles au sens où elles permettent de donner forme à des savoirs spécifiques et à l’esprit qui y accède ; et, si transfert il y a en dehors de l’école (et c’est évidemment la finalité ultime de la formation scolaire), il ne peut se faire qu’indirectement, précisément dans le cheminement propre au sujet ; de l’autre côté, on suppose les apprentissages scolaires soumis à la fois en amont et en aval à des compétences identifiables et transférables ; là encore les deux positions sont logiquement et théoriquement défendables, pour peu qu’on y voie les intérêts comme les effets pervers respectifs, et qu’on ne les identifie pas a priori comme motivées par de sombre desseins idéologiques…
La didactique engage une deuxième inflexion qui me permet de spécifier encore notre problématique ou la lecture que j’en ai : pour ma part, ce n’est pas tant l’élève qui importe que l’apprenant, autrement dit le sujet didactique constructeur d’un apprentissage d’un contenu disciplinaire par la médiation d’un enseignant. Dans cette perspective, la question qui se pose à la didactique est double : comment apprend-on à être auteur ? Qu’apprend-on en étant auteur ?
Si j’ai essayé ici, dans une perspective didactique, de motiver le passage de l’enfant-auteur à l’élève-auteur, il me faut encore interroger la question même de l’auteur, telle que la didactique l’a appréhendée. Il faut, pour aborder une telle question, se rappeler les moments théoriquement importants que constituent les réflexions des années 1950-1960 concernant la littérature : on se rappelle le décret de la « mort de l’auteur » (titre d’un article de Roland Barthes, en 19683). Cette tradition récente, qui a renouvelé les études littéraires, est évidemment interrogeante dans notre questionnement d’aujourd’hui. Je vais développer cette question, en avançant un paradoxe : il me semble que c’est précisément la « mort de l’auteur », décrétée dans ces années-là, qui nous permet aujourd’hui de parler sérieusement de l’enfant-auteur. Mais à certaines conditions, que je vais essayer de préciser.
Les philosophes et théoriciens de la littérature de ces années-là n’ont pas joué avec les évidences : des auteurs, il y en avait, ils le savaient bien, et ils ne s’empêchaient pas de parler de Racine, de La Fontaine, de Sade, de Flaubert, de Sartre ou de Beckett… Ce qui était en jeu alors était une contestation d’une certaine configuration théorique impensée qui ramenait la littérature à l’individu-auteur. Et cette configuration théorique était illustrée exemplairement par l’approche scolaire de la littérature.
On se rappelle que les manuels scolaires de l’époque (dont le « Lagarde et Michard » était l’exemple type), se présentaient comme des anthologies, c’est-à-dire comme des successions de textes d’auteurs. Et c’est ce qui fondait les critiques qui leur étaient adressées : on peut isoler, dans l’ensemble des critiques faites, une idée centrale, que Pierre Kuentz4 a formulée le plus clairement : la « belle page », le « texte », le « morceau choisi » construit la fiction d’un discours littéraire homogène, une fois gommées les différences linguistiques, typographiques, contextuelles, etc., comme s’ils étaient des fragments de la littérature. À partir de ce constat, les autres critiques prennent sens et s’articulent aisément entre elles : canonisation des textes littéraires que permet la pratique de l’anthologie ; constitution d’un patrimoine national obéissant à des critères qui ne sont pas que littéraires ; exclusion des textes qui ne cadrent pas (pour des raisons esthétiques ou morales, voire politiques) avec la conception non explicitée du beau texte ; permanence du discours sur l’homme que véhicule une approche humaniste et anhistorique de la littérature, confortée par une projection de la personne sur le personnage, conception de l’œuvre comme expression d’un auteur – explication de l’importance du discours biographique et psychologique dans les manuels…
C’est tout cela que les théories les plus avant-gardistes des années 1950-1060 voulaient dénoncer, dans la décision théorique de la mort de l’auteur. L’auteur, en effet, représentait cette fixation idéologique (j’emploie les termes de l’époque) sur l’individualité et son expression personnelle : car seule cette idée permettait de constituer une sorte de continuité entre les individus, qui s’expriment entre eux, de Sophocle à Beckett en passant par Shakespeare et Racine. De nombreux théoriciens (empruntant aux approches psychanalytiques, marxistes, anthropologiques) ont à l’inverse montré que ce qui s’exprimait n’était pas un individu-sujet conscient de son discours, mais bien autre chose, où se joue l’inconscient (individuel ou collectif), les structures de classes, les formats possibles des discours dans une configuration sociale donnée, les formes esthétiques disponibles, et quelques autres choses, dont, par exemple, les contingences historiques qui expliquent la naissance de tel genre ou de telle forme… Et cela rencontrait une certaine conception de la littérature contemporaine comme travail sur le langage : Michel Foucault5 pouvait écrire par exemple : « l'écriture d'aujourd'hui s'est affranchie du thème de l'expression ».
Faire mourir l’auteur, autrement dit, c’était faire mourir une certaine idée de la littérature et de son apprentissage : l’auteur ne s’exprime pas, il exprime un état de la société et de la sensibilité d’une époque et, en ce sens, lire Racine, ce n’est pas lire des vérités intemporelles sur la personne humaine, ses passions et son destin, c’est lire une modalité de construction d’un discours qui rencontre, à un moment donné, une certaine configuration sociale qui rend possible ce discours, aussi bien sur le plan formel que sur le plan du contenu … Autrement dit, une tragédie de Racine peut bien « nous parler », comme on dit, mais ce n’est pas Racine qui nous parle… Faire mourir l’auteur, c’était en quelque sorte faire advenir le lecteur, renoncer aux intentions d’auteur, au vouloir-dire, au profit de l’analyse d’un dire.
Prenons un exemple simple : je lis Phèdre, et j’y vois, par une sorte d’émotion qui m’étreint le cœur et les boyaux, quelque chose de ma vie et de mes impossibles amours, de mes désirs que mon propre état m’interdit de vivre. A ceci près que quand Racine écrivait Phèdre, ce n’était pas pour créer une émotion chez un lecteur individuel entrant en communication (ou en communion) avec lui dans une sorte d’intersubjectivité que favorise la lecture individuelle dans un fauteuil ou dans un lit : Racine écrivait pour une déclamation publique et collectivement partagée ; mais surtout, si Racine avait l’intention de décrire les émois d’une personne comme moi, indépendamment de la distance des siècles, il les aurait décrits dans… une comédie, seul lieu où je pouvais être mis en scène ! La tragédie s’adressait à des rois et parlaient de rois, la comédie seule aurait pu – qui sait ? – concerner de vulgaires professionnels de la recherche didactique ou de l’enseignement… C’est le changement radical qui s’est opéré au cours du XVIIIe siècle, que de mettre à bas les genres littéraires et ce qu’ils charriaient de fortes contraintes (formelles et sociales). Jacques Rancière6 a bien décrit le caractère « démocratique » de la littérature telle qu’elle apparaît à l’orée du Romantisme : la parole vole, elle se donne à lire à qui veut bien la saisir, indépendamment des contraintes de sa production.
Mais le Romantisme a en même temps promu une conception de la littérature comme expression de soi : l’individu parle à l’individu, quand quelques théories ont avancé depuis que dans une parole, d’autres choses se faisaient entendre, comme on l’a vu. C’est en ce sens que les théories des années 1950-1960 étaient antisubjectivistes, niant au sujet une conscience claire de son propos, ce qui interdisait la consécration de l’homme et de l’œuvre, mais aussi de ses intentions que nous aurions pu, sans médiation particulière, retrouver sous le discours.
Il y a quelque étonnement pour ceux qui ont connu cette histoire théorique, qui se confond avec le développement de la réflexion pédagogique (qui deviendra didactique) sur l’enseignement de la littérature, dans le « retour du sujet », je dirais même son inflation. Pour en rester dans mon domaine, celui de la didactique, il est frappant de voir resurgir comme des slogans des expressions telles que le « sujet lecteur », le « sujet scripteur ». Certes, le retour au sujet : mais doit-il occulter les raisons de l’effacement du sujet ? Certes, le retour de l’auteur : mais doit-il négliger les questions que le décret de sa mort avait suscitées ?
Ce disant, je ne mets pas en cause l’objet de ce congrès ! En effet, quand un congrès Freinet pose la question de l’enfant-auteur, il ne le fait pas en brandissant un slogan, mais en s’inscrivant dans une tradition quasi-séculaire : car la question est posée depuis les premiers travaux de Freinet. Mais, précisément, ce qui m’intéresse est la permanence de cette question, malgré les changements théoriques qui ont pu apparaître entre-temps ; et ce qui m’intéresse aussi est la rencontre entre cette réoccupation et celles qui peuvent intéresser la didactique.
Je disais que la notion d’enfant-auteur pouvait précisément reprendre une nouvelle légitimité de la mort de l’auteur, c’est-à-dire de la mise en cause d’une certaine idée de l’auteur. Pourquoi ?
– d’abord, en parlant d’enfant-auteur, on gomme en partie son histoire propre : d’une part, on ne peut pas se contenter d’enregistrer le discours de l’enfant comme une expression transparente de sa vie, d’autre part, l’important est précisément de faire résonner ce qui, dans ce qu’il dit, le dépasse et fait écho aux autres textes, aux autres auteurs… Dans une démarche littéraire, on laisse s’exprimer l’enfant, mais on ne le constitue comme auteur que dans la séparation de son discours et de sa personne ;
– ensuite, on suppose légitime une parole qui n’est pas celle d’une pure subjectivité, mais l’expression d’un discours possible, à un moment donné, dans une configuration particulière ;
– on s’intéresse moins à des auteurs canoniques qu’à ce qui fait advenir l’écriture, en supposant à l’écriture un sens spécifique, sur lequel on reviendra, mais que l’on peut caractériser, après Barthes (et Clanché7, qui en a fait un usage intéressant pour décrire le texte libre de Freinet) comme en rupture avec l’écrivance (qui met en relation un dire et son contexte, dans une logique de communication d’un message) : dans l’écriture littéraire, se joue le lien entre un dire et ses effets, mais loin de tout vouloir-dire, loin de toute intention consciente.
Autrement dit, dans une démarche littéraire, constituer l’élève comme auteur, c’est précisément, d’une certaine manière, évacuer l’enfant…
La question reste de savoir ce qu’est un auteur dans une situation scolaire. Être auteur, ce n’est pas seulement entrer dans une relation de scripteur à lecteur, dans une régulation sociale spécifique que sanctionne une note ; on pressent bien que dans la revendication de l’enfant-auteur, s’insinuent quelques autres exigences, que je ramènerais à trois :
– la première est de supposer l’enfant porteur d’une créativité, qui doit advenir par un dispositif qui met en cause les règles ordinaires de la production d’écrits à l’école ; on suppose que l’enfant, dans sa spontanéité, mais aussi selon des conditions scolaires spécifiques, peut révéler en lui-même des potentialités que l’école, dans ses pratiques ordinaires, empêcherait ;
– la deuxième exigence est de considérer ce geste de la constitution de l’auteur comme un geste littéraire, différent d’autres formes de productions scolaires ;
– la troisième exigence est de constituer une communauté d’acteurs, qui se répondent les uns les autres : l’auteur, les lecteurs, les commentateurs, les éditeurs, dont les rôles, dans la communauté constituée, sont interchangeables.
Ce sont ces trois exigences que je vais maintenant examiner rapidement, en précisant ce que la didactique a pu en dire.
2. L’enfant créateur
Bruno Duborgel8 interroge « l’iconoclasme scolaire » que promeut ce qu’il appelle un certain « pédagogisme », en invitant à un « Nouvel esprit pédagogique » (en référence au « Nouvel esprit scientifique » de Bachelard), susceptible d’ouvrir à une « culture des songes ». Duborgel, par une démonstration très argumentée, montrait, aussi bien pour ce qui est du rapport aux images qu’aux textes, en réception comme en production, que l’école non seulement ne développait pas mais bridait l’imaginaire, travaillant à faire advenir un être de raison dont on pouvait penser qu’il devait domestiquer l’imaginaire. On reconnait là un de ces pôles dont je parlais plus haut. Et force est de donner raison à Duborgel, à la lecture des discours de l’école, tout au long du XXe siècle, qu’il analyse d’ailleurs et qui ont fait également l’objet d’analyses didactiques ; en effet, les instructions officielles françaises et leurs inspirateurs désignent assez clairement le danger de l’imagination, cette « folle du logis » (Malebranche), cette « maîtresse d'erreur et de fausseté » (Pascal). Gabriel Compayré écrivait, dans le grand Dictionnaire de Ferdinand Buisson9 :
Les œuvres de l’imagination créatrice sont les fictions de toute espèce, celles qu’enfante le poète, comme celles qui égarent le fou. Seulement le poète n’est pas dupe de ses inventions imaginaires, tandis que le fou croit à la réalité de ses chimériques rêveries.
On imagine bien que l’imagination de l’enfant est plus du côté du fou que du poète, précisément quand il est considéré comme n’ayant pas la maîtrise de son langage ni de sa pensée. L’imagination créatrice doit donc être bridée, y compris dans le récit de fiction, utilisé « pour discipliner l’imagination » (Martine Jey10), d’où le recours à l’expérience vécue, dont on sait bien aussi qu’elle ne fonctionne à l’école que fictionnalisée, c’est-à-dire quand elle donne tous les gages d’un discours pré-construit, à la fois correct formellement, moral et vraisemblable…
Mais enfin le procès inverse avait déjà été fait aussi, celui du mythe de l’enfant créateur, dont Barthes a tracé les traits dans un article célèbre de ses Mythologies, « La littérature selon Minou Drouet » :
Croire au « génie » poétique de l’enfance, c’est croire à une sorte de parthénogénèse littéraire, c’est poser une fois de plus la littérature comme un don des dieux.
Ce que Barthes dénonçait était finalement la conjonction de deux mythologies, celle de l’enfance et celle de la création poétique, qu’il ramenait à des conceptions idéologiques, qu’il dénonçait.
Il est clair du reste que tout discours sur la créativité à l’école suppose une certaine conception de l’école et de l’enfant, mais aucune étude théorique ni aucun corps de savoirs ne remplaceront un positionnement ancré dans des convictions empruntant à des sources diverses. Et il me semble que la solution la plus raisonnable est de sortir des anathèmes en la matière, en tenant compte des phénomènes de tensions que nombre de théoriciens ou de praticiens ont déjà observés, entre l’enfant et l’élève, pour désigner (avec les termes que j’ai avancés tout à l’heure) les deux parts du sujet dont le développement doit être harmonieux sans pour autant toujours pouvoir l’être.
Si Freinet a posée de façon exemplaire la question de l’enfant-créateur, la didactique s’en est saisie depuis les années 1970 particulièrement, parfois en se démarquant de façon excessive (et sans doute en partie injuste) de la pédagogie Freinet, par exemple en mettant en cause « le concept d’une création littéraire naturellement jaillie de l’affectivité enfantine » (Romian11). Mais Françoise Sublet12, par exemple, justifiait une démarche en trois temps, typique du plan de rénovation :
a) partir de l’expression spontanée des enfants, de leurs sensations, de leurs émotions et de leur imagination ;
b) passer par une phase de structuration, faite d’explorations plus systématiques ;
c) aller vers une expression libérée.
Hélène Romian (ibid), citant le plan de rénovation, décrit ce processus, en précisant l’usage des textes littéraires comme appui à la structuration, et en ajoutant la nécessité de ne pas « confondre pour autant les trouvailles des enfants, leurs découvertes quel que soit leur intérêt, avec un art conscient de lui-même. Il s’agit simplement de faire pénétrer le travail de création par les chemins de la création même ». Et là, quoi qu’on en dise, Freinet et les Rénovateurs des années 1960-1970 se rejoignent.
Avec sans doute une différence de taille : si le texte libre n’est pas exclu des possibles (et je parle bien du texte libre, non de ses avatars), il n’est pas central ; mais surtout, la part de l’exercice y est sans doute plus développée, le pari étant que, dans le processus de création, l’exercice est central. Et les propositions ont été nombreuses, en la matière, au sein de l’INRP dans le cadre ou dans la suite de la rédaction du Plan de rénovation, dont je viens de parler, ou de la part de personnes qui n’étaient pas des didacticiens mais qui ont contribué à une réflexion didactique sur le rôle de l’école dans le développement de la créativité : qu’on pense à Georges Jean – qui interroge, dès les années 1970, la question de la créativité de l’enfant dans un cadre pédagogique13 – ou à Jacqueline Held – qui a contribué à une réflexion sur une pédagogie de l’imaginaire14 ou encore à Gianni Rodari15.
Ce rôle de l’exercice me paraît poser les termes d’un débat que j’ai déjà évoqué, concernant les places respectives de l’enfant et de l’élève. Françoise Sublet (1972), dans son article introductif aux deux numéros de Repères (n° 16 et 17) intitulés L’enfant et la poésie. La créativité enfantine, écrit (1972, p. 12) :
La conduite créatrice est dépendante de l’entourage de l’enfant, de son milieu socioculturel et familial, de son histoire personnelle. Que devient cette créativité au fur et à mesure que l’enfant grandit ? D’une part s’exerce la pression de l’École très attachée encore à développer la pensée « convergente » et le conformisme.
D’autre part, pour beaucoup d’enfants, que veut dire « développer leur créativité », quand un de leurs premiers soucis sera de trouver une voie d’orientation, un travail où précisément on leur demandera surtout de ne pas exercer leurs facultés créatrices ?
On voit bien dans ce passage la double orientation qui est donnée : c’est bien l’enfant qui est en cause, en amont comme en aval de l’école, et c’est l’enfant dans une perspective développementale, où précisément l’école est identifiée comme y contribuant mais dans le seul sens d’une acculturation à des pratiques langagières non créatrices.
Le déplacement didactique est net quelques années plus tard, quand Yves Reuter16 replace clairement la question sur le plan didactique, en identifiant des « propositions très concrètes pour aider les apprenants à écrire ». L’imaginaire et la créativité ne sont plus alors conçus comme relevant d’un univers extrascolaire, mais comme au contraire intégrés à l’univers scolaire, qui les façonne comme les autres lieux sociaux. Ce n’est plus l’enfant qui est en jeu, mais l’apprenant, en tant que sujet visé par l’approche théorique qui est la sienne.
La poésie a eu une place de choix dans les propositions pédagogiques et didactiques de développement de la créativité à l’école, là encore dans un mouvement qui conçoit la poésie comme le propre de l’enfance. Sublet (article cité), rendant compte de ses recherches des années 1970, rappelle les réflexions centrales sur ce que l’on appelait alors le « langage poétique », dont elle développe les caractéristiques :
Par ces dimensions sonores, elle [la poésie] renvoie aussi à la jubilation de l’enfant découvrant le plaisir de jouer avec sa langue, bien avant l’acquisition du langage verbal, puis au plaisir de dire certaines formes populaires de la poésie orale (comptines, berceuses, dictons…). Reconnaitre cette particularité permet donc d’envisager l’accès au poétique comme une prise en compte des pratiques effectives des enfants, en tant que producteurs ou récepteurs de ces jeux sonores.
On voit bien comment la poésie, introduite à l’école, est susceptible de développer sa créativité en créant un point de rencontre entre l’enfant et l’élève, vers une scolarisation ou une didactisation qui envisage la poésie comme susceptible de développer les capacités langagières de l’apprenant : c’est sans doute par ce glissement que l’on peut expliquer le développement et la place prééminente, à une époque, en matière d’écriture du moins, des « jeux poétiques » à l’école.
Cette didactisation de la créativité de l’enfant est en fait un ressort pour des apprentissages langagiers, qui trouvent leurs sources dans la pratique ordinaire du langage mais qui fondent la pratique scolaire du langage, qui institue la distanciation17 : les jeux avec le signifiant, la dissociation du signifiant et du signifié, l’interrogation du sens littéral et des effets de sens, la dissociation de l’énoncé et de son contexte, la clôture du texte, le jeu avec la page écrite, la dissociation de l’oral et de l’écrit, la réflexion métalinguistique sur le fonctionnement même du langage, etc. : tout cela, qui fonde la spécificité du rapport au langage que l’école veut construire, est en germe dans la pratique ludique du langage chez l’enfant. Et son appel à la créativité, c’est-à-dire finalement la reconnaissance de sa capacité à jouer de la langue, avec la langue, est, d’un point de vue didactique, un moyen de faire advenir chez l’élève ce qui est finalement déjà là chez l’enfant.
Cela dépasse du reste de beaucoup la seule question du jeu avec le langage, et renvoie à la prise en compte d’un déjà-là en terme de savoir écrire, savoir faire de la littérature, ce que Marie-Claude Penloup appelait la « tentation du littéraire » que peut receler l’écriture « ordinaire », « extrascolaire », à tous les niveaux d’étude18.
Mais toute la question – et elle reste entière – est précisément de penser l’articulation d’un déjà-là et d’un advenir qui ne soit pas une pure instrumentalisation pédagogique ou didactique à des fins qui négligeraient précisément ce qui caractérise l’enfant… Sortir d’une observation béate de ce que sait faire l’enfant pour parvenir à fonder sur lui les apprentissages didactiques qui concourent à son développement d’enfant, tel est sans doute ce qui caractérise le projet de faire de l’enfant un auteur. Dans une telle proposition, c’est une instrumentalisation inverse qui s’opère : le but n’est pas de faire de l’enfant ou de reconnaitre chez lui un auteur au sens littéraire du terme, c’est d’user de cette revendication didactique pour l’engager dans des apprentissages.
3. L’enseignement de la « littérature »
Il n’est pas possible de poser la question de l’enfant-auteur, dans la perspective que je dessine, sans interroger la dimension littéraire de cette constitution de l’enfant-auteur. Or la question d’une définition de la littérature n’est pas simple…
Si à peu près tout le monde aujourd’hui s’entend sur le fait que l’on ne saurait définir « la » littérature sans, par une telle décision, exclure une partie des textes que d’autres définitions incluraient, il n’empêche que le mot fonctionne et est constamment utilisé, sans que soit toujours précisément défini ce dont on parle, sans même que soit toujours prises en compte les « hésitations et tensions lexicales »19 que recèle l’usage du terme littérature, notamment en raison de l’extension du terme à des œuvres d’avant la naissance du mot et dont certaines ne relèveraient pas spontanément du corpus que le mot, dans son acception actuelle, peut désigner…
Certes, Danièle Sallenave20, posant à son tour la question : « Qu’est-ce en effet que la littérature ? » peut répondre sans aucune hésitation : « Une conscience qui s’expose dans l’épreuve singulière du monde, qui met en scène dans son langage propre la diversité possible des expériences humaines : ce qu’on appelle un auteur ». Mais on a peine à fonder un enseignement sur une telle définition, dont chaque mot mérite d’être interrogé, comme on l’a vu plus haut : qu’est-ce qu’une conscience dans notre conception de l’esprit humain ? Qu’est-ce qu’une « épreuve singulière » ? Qu’est-ce qu’un « langage propre » ? Qu’est-ce que l’« expérience humaine » ? Une telle définition a l’avantage de valoir pour toute production langagière… Mais que dit-elle de la littérature effective ? Et que dit-elle de la production d’enfants non reconnus par Sallenave ? Car peut-on supposer qu’elle instituerait elle-même comme littéraire les textes libres produit par une classe ?
Il faut, tout simplement, reconnaitre là la nécessité de passer par une définition institutionnelle de la littérature : est littéraire, finalement, ce qui est institué comme telle par une communauté légitime, l’institution littéraire… Quand on parle de littérature, on oublie en effet trop rapidement que son fonctionnement réside dans une institution littéraire, avec l’effet nécessaire de la légitimation : la littérature est le lieu idéal du jugement de valeur et donc de l’exclusion, dont témoigne les termes multiples qui régissent cette institution : paralittérature, périlittérature, littérature de gare, littérature de jeunesse, voire « textes d’enfants ». Les déterminations de la dénomination de la littérature sont toujours socialement discriminantes et personne ne saurait sérieusement tenir pour de la littérature ce qui est de l’ordre de la production de masse – sachant que même dans la « littérature de jeunesse », par exemple (mais il en est de même de la paralittérature), les hiérarchisations culturelles fonctionnent aussi bien que pour les autres formes de littérature.
Cette institution littéraire est en général définie par un certain nombre d’instances, les éditeurs, les critiques littéraires, les universitaires professionnels de la littérature… Mais aussi l’école, tant elle est posée souvent comme le lieu institutionnel qui permet la « définition » de la littérature. Ce qui amenait Roland Barthes21 à déclarer : « La littérature, c’est ce qui s’enseigne, un point c’est tout »…
Il y a donc eu de nombreuses tentatives de définir didactiquement la littérature. Inutile de préciser que, là encore, les définitions sont multiples, et renvoient à des conceptions diverses de la littérature, avec une place importante donnée soit à la dimension esthétique, au jeu sur le langage, au caractère polysémique du texte, à la finalité du plaisir (en production comme en réception), au jeu avec les stéréotypes, à la distance opérée sur le regard porté sur le monde, au trouble que peut créer l’identification du lecteur au texte, à l’émotion qu’il suscite, à sa dimension formelle, à ses résonnances avec d’autres textes, autrement dit l’intertextualité, à la création de mondes divers, aux fonctions symboliques ou anthropologiques que recèlent les textes, aux savoirs sur le monde que construit le texte, etc. Toutes ces définitions peuvent par ailleurs entrer en tension entre elles, d’où d’innombrables débats…
Mais on voit bien en fait que ce qui compte n’est pas de savoir si un texte est littéraire ou non, mais ce qui peut, dans telle configuration historique, à tel moment de l’histoire des individus, déterminer ce qui fait le caractère littéraire ou non d’un texte produit. En ce sens, instituer l’enfant-auteur, c’est l’engager dans cette interrogation-là. Poser a priori que ce que produit tel enfant est de la littérature est toujours possible : mais cela est en quelque sorte une pétition de principe, qui ne rencontre pas les questions que la société se pose sur son art littéraire. Et cela ne trompe finalement personne : on désignera comme littéraire telle production d’enfant dans une situation scolaire, pour ensuite redonner ses droits, dans l’usage ordinaire du mot, à une définition très institutionnelle de la littérature.
En revanche, c’est le moyen pour l’élève d’éprouver ce questionnement. Comme souvent en matière scolaire, finalement, ce n’est pas tant la réponse qui importe que la question : l’enfant-auteur dans cette optique, est un élève qui interroge en acte ce qu’est la littérature. En ce sens, il ne fait pas de la littérature, il éprouve par son geste les questions fondamentales que pose la définition même, pour une société donnée, de ce qui peut être ou non institué comme littéraire : ce que peut apporter l’instauration de l’enfant comme auteur, c’est de lui faire mettre à l’épreuve finalement quelques-unes des définitions de la littérature et découvrir, par la pratique, des questions concernant finalement le concept de littérature. Il convient donc à notre tour de ne pas nous embarrasser de la question de la définition de « la » littérature, mais de tenter de concevoir la pratique de la découverte de ce que l’on peut, par tâtonnements multiples, et dans une perspective développementale, entendre par littérature dans une société, et dans des pratiques culturelles diversifiées.
C’est précisément là que se joue l’un des intérêts majeurs d’une approche didactique de l’écriture littéraire. Car, finalement, le système scolaire ne conçoit la littérature pratiquement que dans la lecture littéraire, indépendamment de toute écriture.
4. Une « communauté » d’auteurs-lecteurs
L’écriture littéraire rompt avec cette logique mortifère, qui ne suppose la littérature que l’objet d’une vénération, d’une lecture de textes produits et déjà sélectionnés, ceux de l’institution littéraire, pour interroger la littérature comme pratique. Or cette pratique est collective, au sens où il n’y a pas d’auteur en soi : l’enfant ne s’éprouve pas auteur tout seul, il vit cette aventure par le regard des autres, institués par là-même lecteurs.
De nombreux travaux ont été menés depuis, en didactique du français, pour identifier les modalités de constitution de « communautés » scolaires – ou didactiques – de production de textes, à visée esthétique ou non, qui permettent de penser la question de l’élève-auteur dans une perspective d’apprentissage de l’écriture, de la lecture et de la littérature.
Il ne faut pas confondre cela avec les propositions de production d’une œuvre publiable, diffusable au sein même de l’institution littéraire (je ne parle pas des diffusions dans un journal scolaire ou par Internet : on y reviendra). Si cette tentation interroge le statut de la littérature enseignée, elle ne saurait se muer en réel projet didactique : publier tous les romans qu’écriraient des élèves dans des démarches de projet n’aurait pas grand sens ni même un début de pertinence économique et sociale et pose surtout le problème de la raison d’être de cette démarche. Parmi les critiques qui en ont été faites, signalons celle de Jean-François Halté22 :
Il ne s’agit pas d’ouvrir l’école sur la vie, en faisant de vrais livres, édités par des professionnels et destinés au public de l’institution littéraire. Sous cette illusion de l’authenticité, on trouverait aisément une idéologie productiviste de la littérature, inconciliable avec l’apprentissage, mais bel et bien compatible, par contre, avec un certain élitisme et certaines procédures de fonctionnement au talent et au don.
Ce sont d’autres voies qu’a explorées la didactique. L’exemple le plus clair est l’écriture en projet quatrième décrit Halté, associée à un cadre didactique qui pense la production du texte. Mais d’autres propositions didactiques ont été faites, particulièrement pour le primaire : des chantiers d’écriture du Groupe de recherche d’Écouen à la lecture-écriture en réseau, en passant par les ateliers d’écriture introduits dans l’école. Dans la logique de l’écriture en projet, Jean-François Halté interrogeait la possibilité d’instituer une « communauté des apprentis, sous leurs différentes instanciations (d’écrivains, de public, de critiques, de théoriciens) ». La littérature est alors conçue « en tant que savoir-faire objectivé dans des œuvres, en tant que réservoir social de solutions, de problèmes, d’entreprises tentées dans telle ou telle direction des composantes de la scripturalité » : ce qui revient à faire que la littérature est « délibérément exploitée, pillée, dans un geste iconoclaste ».
Cette dimension intertextuelle est d’une importance capitale : il n’y a d’auteur que par la confrontation aux autres auteurs. La conception de l’écriture spontanée est très étrangère à tout ce que nous dit la littérature qui, au contraire, est totalement tissée de liens avec les autres textes. « Réservoir social de solutions, de problèmes, d’entreprises tentées », dit Halté : en fait, l’expérience littéraire d’un enfant est précisément de s’essayer à écrire comme d’autres ont écrit, avec (parfois contre) eux. C’est dans cette lignée qu’il faut inscrire certaines recherches qui cherchent à instaurer une posture d’auteur, au sein d’une communauté littéraire.
Mais cela demande la construction d’une communauté de lecteurs, précisément capables de prendre eux aussi cette posture de lecteurs – cela vaut pour les élèves comme pour l’enseignant du reste. Ce qui exige là encore le même travail de décentrement que l’on suppose à l’élève en posture d’auteur : dans les deux cas, prendre une posture d’auteur ou de lecteur exige de se déprendre de la situation et de soi-même, passer de l’expression à l’effet-lecture23, identifier la matérialité du langage, évacuer ou minorer l’intention de l’auteur, supposer – et construire – la polysémie du texte et la diversité les interprétations possibles, convoquer un intertexte, constituer un patrimoine commun mais le dépasser pour le faire dialoguer avec un patrimoine universel : bref, identifier les modalités de constitution de la littérature.
Cela n’est pas si simple, on le sait – et les nombreuses discussions sur les modalités mêmes du texte libre en attestent du reste. Notamment parce que surgira toujours un paradoxe, celui de la nécessité scolaire d’une référence à la norme (ce qui peut se dire ou s’écrire, la norme linguistique, la norme textuelle…), nécessité que l’on ne peut pas évacuer d’un revers de main, mais qui entre en contradiction avec le jeu sur la norme que la littérature a toujours joué. Autre difficulté : comment ne pas centrer la réflexion sur les seules intentions de l’auteur pour parler des textes, sans pour autant retomber dans le risque de la seule expression de soi, qui irait contre les intérêts mêmes de la posture d’auteur ? Il n’y a pas de solution miracle : là encore, ce qui compte n’est pas de faire de la littérature, mais d’interroger le jeu possible avec la norme ou avec le discours ordinaire : que faire autrement que par les tâtonnements d’élèves et d’enseignants, pour atteindre un objectif sans cesse remis sur le métier…
L’instauration d’une « communauté des apprentis, sous leurs différentes instanciations (d’écrivains, de public, de critiques, de théoriciens) », comme le voulait Halté, est une proposition qui dépasse le cadre strict qui est le sien : ce qui compte, dans une telle démarche est finalement la construction collective d’une certaine conception des textes, qui interroge les conditions scolaires de l’écriture. La place de la réécriture, dans ce cadre, est fondamentale, pour plusieurs raisons : d’une part parce que cette exigence de réécriture, en soi, instaure la distance de l’auteur à son texte ; d’autre part, pensée dans une communauté d’auteurs-lecteurs, elle construit l’image d’un auteur collectif, qui brise avec l’idée d’un sujet-auteur individuel – ce que le travail de groupe, du reste, permet aussi (quand les élèves écrivent en groupe, la question du statut même de l’auteur est questionnée en soi) ; par ailleurs, la réécriture, comme on l’a vu plus haut, n’est finalement que le lieu d’interrogation de ce que peut être un texte littéraire et les choix finaux de l’auteur diront en fait où il en est de sa propre conception de la littérature.
C’est donc bien la posture d’auteur qui est visée : comment se situer, comme auteur d’un texte, dans une relation avec des lecteurs et dans une conception du texte qui se donne à lire au-delà de la communication immédiate. Mais une question se pose : il n’y a auteur que par la distance que crée la diffusion du texte : on n’est pas auteur dans sa classe, en discutant avec des lecteurs en présence, dans un dialogue entre subjectivités sans distance, mais quand la parole volera ailleurs, et que s’en emparera un lecteur qui ne connaitrait ni les conditions de production ni la personne même de l’auteur : car la définition moderne de la littérature exige – et là au moins tout le monde est d’accord –une destination aléatoire, comme un jugement critique porté sans référence à la situation de production. La diffusion par l’Internet, plus que ne le permettait l’imprimerie, modifie déjà, on le sait, cette dimension de la destination aléatoire : il y a là une potentialité considérable qui modifie le statut même du texte de l’enfant-auteur, jusque dans les exploitations inattendues qu’elle permettra.
Mais, pour l’heure, les conditions sont rarement réunies d’une telle distanciation, en situation pédagogique : mais on mime ce geste de la distanciation ; on « fictionnalise », diraient certains didacticiens, cette situation de production de l’œuvre littéraire ; on fabrique une « fiction d’auteur ». Mais c’est dans cette fabrication que réside précisément l’effet d’apprentissage que l’école autorise.
Conclusion
Les réflexions de Célestin Freinet ont accompagné les travaux de didactique sur la question de l’élève-auteur, mais de manière paradoxale : dans un premier temps, on l’a vu, ce fut plutôt pour s’en démarquer, alors que les développements récents ont plutôt visé une articulation avec les propositions pédagogiques de Freinet : les questions de la posture d’écrivain ou d’auteur prise par les élèves, le rôle de la destination des écrits, le statut du stéréotype et de l’intertextualité, la confrontation aux textes d’auteurs pour travailler le texte produit, trouvent dans les propositions de Freinet comme de ses continuateurs des éléments de réflexion qui peuvent aisément s’articuler aux recherches didactiques actuelles (cf. les travaux décisifs de Pierre Clanché ou d’Alain Vergnioux24).
Ce qui est important à mes yeux dans la reconnaissance de l’enfant comme auteur est le mouvement de transformation de l’enfant en auteur. Et le lieu de cette transformation est l’école, qui fournit à l’élève une confrontation à des formes, des normes, qui le dépassent, le font se dépasser en l’inscrivant dans un travail, que Freinet a si justement décrit, qui donne à son activité la possibilité de s’inscrire dans une activité collective et historique, qui lui font vivre l’expérience de l’altérité, plus que de l’identité…
Mais ce que l’expérience de la littérature permet dépasse, finalement, la littérature : dans ce mouvement de constitution de l’auteur, qui est si visible dans le cas de la littérature, c’est l’expérience de tout apprentissage qui est en jeu : être auteur, indépendamment de toute revendication littéraire, c’est se faire l’auteur de ses apprentissages. Il me semble que, dans un tel projet, le dialogue entre le mouvement Freinet et la didactique n’est pas près de s’interrompre…
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| conf-daunay.jpg | 32.38 Ko |