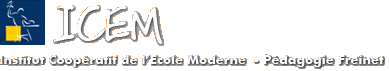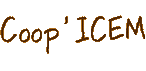Dans : Français › Techniques pédagogiques ›
Juin 2011
ON PARLE DE NOUS
revue française de pédagogie n° 66
CLANCHÉ (Pierre). - L'enfant écrivain : génétique et symbolique du texte libre.
- Paris : Le Centurion, 1988. - 208 p. ; 21 cm. - (Païdos).
Pierre Clanché, professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Bordeaux II, a analysé 7619 textes libres écrits durant une année. dans 20 classes coopératives (Freinet), par 200 enfants de 6 à 10 ans.
Dans un travail antérieur (publié sous forme condensée dans un petit livre intitulé Le texte libre, écriture des enfants (Maspéro), Pierre Clanché avait mené une enquête portant sur 700 textes écrits par 33 enfants d'un CE1 - Freinet - : il s'agissait d'un essai de « lecture textuelle », d'une comparaison avec quelques techniques projectives. L'hypothèse théorique qu'il avait alors prenait résolument le contre-pied de l'idée d'un progrès littéraire calqué sur les progrès cognitifs. II pensait que l'évolution se faisait par perte, la correction croissante du support linguistique devant entraîner un affaiblissement de la créativité littéraire. Il pense aujourd'hui que l'idée d'une perte de créativité n'est pas plus à retenir que l'hypothèse d'un parallélisme entre le progrès cognitif et le progrès créatif. Selon Pierre Clanché si progrès ou perte il y a - c'est le fait exclusif de la richesse ou de la pauvreté du milieu pédagogique (p. 7).
Quelles sont les questions explicitement formulées auxquelles le dernier livre de Pierre Clanché se propose de répondre ?
Qu'est-ce que le texte libre, dans quel cadre pédagogique apparaît-il ?
Qu'est-ce que les textes libres ont, à voir avec ce que l'on appelle couramment littérature ?
Comment évoluent-ils et vers quoi ?
De quoi peuvent-ils bien servir ?
De quoi peuvent-ils être révélateurs ? ».
Dans le premier chapitre sont exposés les six invariants de la pédagogie Freinet et les cinq invariants d'une pratique du texte libre.
Dans le second chapitre Pierre Clanché indique comment il aborde les productions littéraires des enfants : comme des textes tout court, non comme des textes d'enfants (il considère qu'il faut se débarrasser des a priori scolaires et psychologistes). Il reprend la distinction effectuée par Roland Barthes entre écrivant et écrivain. (L'écrivant est celui pour qui le texte est un instrument ; la fonctionnalité du texte est située hors du texte lui-même: le texte sert à... L'écrivain est celui pour qui le texte est l'objet ultime de l'activité d'écriture). Pierre Clanché en vient alors à une remarque capitale : pour accéder à une pratique littéraire de l'écriture, il faut d'abord commencer par tuer le texte en tant que fétiche (- cette démythification de l'écriture par l'usage quotidien est un mérite peu reconnu du texte libre. Freinet l'avait perçu dès le début... C'est en incitant l'enfant à l'écrivance que le texte libre permet l'accès à l'écriture, p. 35). C'est pourquoi Pierre Clanché revendique pour les enfants un véritable droit à la banalité («l 'institution scolaire, par ailleurs si conformiste, traque la banalité dans les productions écrites et exige une « originalité tout aussi conventionnelle, au lieu de se demander à quoi cette banalité peut servir, et comment on pourrait quelquefois la dépasser ». p. 171).
Il n'en reste pas moins qu'il y a bien des traits spécifiques du texte d'enfant, et Pierre Clanché s'attache avec beaucoup de bonheur et de brio à en montrer la genèse. Cours préparatoire : l'espace de l'énoncé, le trouvé/créé. Cours élémentaire, le temps de l'histoire. Cours moyen : sujet et subjectivité.
La CE2 représente un état d'équilibre entre deux types de récit : le monde commenté et le monde raconté. Le CM voit un retour en force du monde commenté.
La grande nouveauté du CE2 consiste dans l'apparition du sujet de l'énonciation : l'enfant commence à se mettre en scène dans le scénario (« On voit poindre ici le renversement qui sera consommé au CM2 : le déclin de l'histoire et l'envahissement du sujet »). Selon Pierre Clanché, au CP l'enfant parle rarement de lui et, quand il le fait, il ne s'énonce pas en tant que sujet. C'est à la troisième personne que, paradoxalement, le sujet se manifeste (« L'éclatement du sujet gît dans cette contradiction dont la littérature est l'effet : non pas « Je suis un autre » mais « l'autre est Je ». Du CP au CM, le sujet ne se donne pas de plus en plus ni de moins en moins : il s'injecte différemment de l'effraction au CP au phagocytage au CM2» p. 103). Au CM le « Je fictique » et le « Je romantique » confluent pour former « le fleuve des textes dans lesquels le moi revendique bruyamment la totalité du champ de l'énoncé » (p. 105).
En définitive, le CM2 marque le déclin du récit au profit d'un mode d'expression dans lequel le sujet s'investit explicitement en tant que sujet psychologique. Cette évolution conduit à poser deux questions : l'enfant (à La sortie de l'école élémentaire) est-il capable d'employer !e style indirect libre ; de produire des textes théoriques ?
Au CM1, le style indirect libre se manifeste sans ambiguïté aucune; mais s'il est acquis au titre de micro-structure de récit, il n'est pas pour autant intégré à des macro-structures telles que la nouvelle (a fortiori le roman). En ce qui concerne la production de textes théoriques, les linguistes tels que A. Culioli et son équipe montrent qu'elle est conditionnés par une opération énonciative qu'ils nomment parcours. Dans cette opération tout sujet est supposé pouvoir prendre la place du sujet de l'énonciation et c'est cette présupposition qui institue le «sujet universel». En quelque sorte, le parcours est le pendant du style indirect libre (dans le style indirect libre, le sujet occupe toutes les places ; dans le parcours, tous les concepts peuvent occuper sa place). L'étude menée par Pierre Clanché montre qu'on ne rencontre pas d'exemples de parcours dans le texte libre avant le Cours Moyen. Au CM l'autonomie du discursif est en progrès. Il y a bien dans certains textes de la fin du CM2 une discursivité interne du texte: interrogation, hypothèse, déduction, discussion, contradiction. Mais le sujet de l'énonciation s'implique encore en tant que personne afin d'emporter la conviction du lecteur (genre « essai ») ce qui n'est pas le cas pour le texte théorique, dans lequel le sujet de l'énonciation doit s'effacer au profit des objets qu'il pose et met en relation.
En définitive l'approche psycho-linguistique de Pierre Clanche multiplie les variations fécondes et subtiles pour suivre au plus près la production des enfants. Aux enseignants, aux éducateurs, à tous ceux qui veulent comprendre et/ou agir, ce livre offre des outils d'analyse stimulants. Nous nous permettrons une (petite) réserve : Pierre Clanché écrit que "force est de constater que, dans un certain type de rapport pédagogique, l'influence du milieu socio-culturel sur l'écriture n'est pas décisive» (p. 7). Selon P. Clanché le milieu socio-culturel a une influence maximale lorsque la tâche à accomplir est une tâche d'adaptation à une attente implicite de l'enseignant (rédaction) et une influence minimale lorsque la tâche est définie dans un cadre institutionnel explicite mais ne donnant aucune consigne explicite sur la forme et sur le contenu (texte libre). II nous apparaît que ce n'est nullement démontré alors que l'enjeu en question n'est pas de médiocre importance. Il n'en reste pas moins que ce livre - dans son ordre et selon le domaine choisi - nous parait tout à fait remarquable ; il devrait figurer dans toute bonne bibliothèque d'éducateur et d'homme de culture.
Claude LELIÈVRE
Auteur :