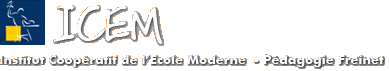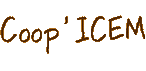|
Au-delà du disciplinaire
La prise en compte de la globalité des apprentissages implique celle de l’enfant, celle des contenus, celle du groupe et celle des relations entre ces composantes. Cela va beaucoup plus loin que l’interdisciplinarité qui souvent est ramenée à un simple agence-ment technique des apprentissages.
Car la globalité ne différencie pas l’enfant de l’apprenant (celui qui la prend en compte a d’ailleurs du mal à parler d’élève). Celle-ci ne hiérarchise pas les savoirs ni les valeurs, elle prend la mesure de l’enfant dans sa condition d’être singulier mais aussi social, en relation avec l’environnement agissant. Son but n’est pas l’entrée en culture mais le positionnement actif de l’individu par rapport à la culture.
Les savoirs ne se structurent pas par accumulation mais de manière beaucoup plus complexe au croisement des différents champs de la connaissance. Un savoir acquis par accumulation est un savoir mort, qui disparaît une fois les examens passés.
Si la notion de globalité rencontre celle de syncrétisme, il n’est pas anodin que l’un et l’autre trouvent une meilleure reconnaissance à la maternelle, s’évanouissant par la suite au profit de la division et de l’analytique. Et pourtant l’adulte gagnerait à avoir entretenu les différentes approches du savoir pour en disposer dans son jugement.
L’image, par sa nature polysémique exige cette appréciation car elle procède de la mesure du plein et du vide, de la forme et du fond, du montré et du caché, de la perception directe et de la culture, etc. Ainsi la différence entre trait et surface a opposé Ingres et Delacroix non pas sur des problèmes internes à la peinture mais comme “ positionnement ” par rapport au monde, le premier définissant un monde à appréhender par le trait, par la rigueur et l’abstraction et l’autre d’une manière plus sensible, plus individuelle, par l’expérience de la couleur.
Des disciplines qui n’apparaissent pourtant pas dans les champs scolaires traditionnels sinon de manière marginale sont pratiquées par les pédagogues Freinet car l’idée de globalité oblige à trouver d’autres manières d’envisager l’espace de travail et le temps didactique… les places du groupe et du maître se modifient, le premier devenant générateur, le second favorisant la recherche documentaire, les échanges, la coopération, les tâtonnements, l’appropriation des savoirs. Dans une dynamique ou la question de la matière enseignée ne se pose pas, tous les domaines sont explorés. Les articles présentés ici nous le montrent : le théâtre qu’il implique des êtres réels ou des ombres, la danse (et non pas la gymnastique rythmique), le jardinage…
L’enseignement traditionnel, frontal, disciplinaire, spécialisé, confiné aux salles de classes et aux manuels scolaires, qui apparaît souvent comme “ naturel ” est un des facteurs d’exclusion les plus manifeste et pourtant jamais nommé comme tel. Pour cela, il nous faut affirmer que la richesse de sens, de savoir, de relation à l’autre dans les démarches de globalité offrent des ouvertures pour sortir de la crise de l’éducation aujourd’hui.
CréAtions
sommaire CréATions N° 107 
|
|