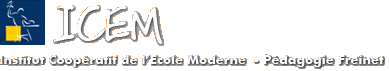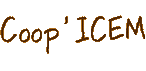Dans : Principes pédagogiques ›
Juin 1996
L'imitation est un phénomène particulièrement fréquent, surtout chez les jeunes enfants ; on le voit bien intervenir dans le processus du tâtonnement expérimental à des degrés divers.
Faut - il le bannir ou au contraire le prendre en compte et en faciliter la régulation ?
L'imitation est un phénomène naturel
C'est une composante de l'apprentissage, comme l'expérience tâtonnée, qui participe au processus d'appropriation de savoirs.
"L'acte réussi, qui répond plus ou moins parfaitement à nos besoins, crée comme un courant vital qui suscite la reproduction automatique, fixée ensuite en règle de vie...
... Or, cette sorte de courant est créé dans les mêmes conditions par les gestes ou les actes extérieurs, qui provoquent la production, par l'individu, d'actes semblables imités. C'est un fait qu'il est inutile même d'expliquer, qui, à l'origine a un aspect physiologique inéluctable - le mimétisme en est l'expression scientifique. Il est comme le sens de la vie, comme le tâtonnement et comme la répétition automatique des actes réussis.
Il y a, dans le phénomène de l'imitation, comme dans celui de l'expérience tâtonnée, une part considérable, et presque exclusive d'automatisme. Cela fait partie de notre besoin pour ainsi dire physiologique de rythme et de résonance." C.Freinet (1)
La perméabilité à l'exemple
Mais cette imbrication naturelle de l'action extérieure dans le tâtonnement expérimental de l'individu varie avec la perméabilité à l'exemple.
"La preuve que notre tendance à l'imitation n'est que l'imbrication naturelle de l'action extérieure dans le processus de notre propre tâtonnement, c'est que la perméabilité à l'exemple cesse dès que s'est terminé notre propre tâtonnement, dès que l'expérience réussie d'abord, puis répétée, s'est fixée dans l'automatisme d'une règle de vie. Quand nous avons déjà, au cours d'un long tâtonnement expérimental, creusé profondément notre trace dans le champ de neige, nous sommes indifférents à cette ligne de pas qui s'en va dans une autre direction. Nous sommes alors imperméables à l'expérience des autres, le processus d'imitation ne joue plus." C.Freinet (1)
A quelles conditions l'imitation s'imbrique - t - elle dans le processus d'apprentissage ?
"L'imitation est en somme le processus naturel par lequel une expérience extérieure s'imbrique dans la chaîne de notre propre expérience. Elle ne peut s'y imbriquer que si la chaîne est en cours de formation ; si elle est déjà définitivement soudée en règle de vie, l'imitation ne fera que se greffer sur notre propre expérience sans s'y intégrer. Il faut aussi que ce chaînon extérieur réponde si bien à nos propres besoins qu'il puisse s'ajuster sans faille à la chaîne de notre expérience. Si les conditions optima de cet ajustement sont réalisées, l'acte imité devient maillon de notre chaîne, aussi solidement soudé à notre comportement que nos propres maillons". C.Freinet (1) (voir encart)
"Nous représentons ainsi le schèma des processus d'imitation" (1)
"Dans la première colonne de gauche, les chaînons imités ne se distinguent même plus des chaînons fonctionnels auxquels ils sont comme organiquement intégrés.
Dans la deuxième colonne, les expériences imitées non intégrées n'arrivent pas à mordre sur la ligne centrale de la chaîne.
Dans la troisième colonne enfin, l'expérience extérieure, au lieu de s'intégrer à la chaîne personnelle qu'elle aurait renforcée, s'est constituée à côté, d'ailleurs plus ou moins bien formée, avec des hiatus, des protubérances et des directions accessoires qui ajoutent encore à l'imprécision de la ligne. L'individu n'aura pas de règle de vie personnelle."(1)
"Ces considérations nous permettent de formuler notre neuvième loi du comportement :
L'imitation et l'exemple (extraits)
L'acte réussi appelle automatiquement sa répétition. L'acte réussi par d'autres entraîne la même répétition automatique lorsqu'il s'inscrit dans le processus fonctionnel de l'individu. Cette imitation d'actes dont nous sommes les témoins a toutes les caractéristiques de nos expériences tâtonnées qui ont réussi...
L'exemple, au même titre que l'expérience personnelle réussie, tend à se fixer en un automatisme qui suscite une tendance, base d'une règle de vie parfois indéracinable. C'est comme un maillon non pas juxtaposé à la chaîne de la vie, mais imbriqué dans cette chaîne, qui en fera à jamais partie et qui, plus ou moins selon la puissance des autres maillons, donnera à la chaîne son aspect et ses qualités déterminants.
Mais on n'imite pas indistinctement tous les actes dont on est témoin..." C.Freinet (1)
C. Freinet analyse et illustre bien l'intégration harmonieuse de l'exemple ou de l'expérience des autres dans le cursus de l'individu mais aussi les risques d'une imitation mal intégrée. Cependant nous observons aussi, dans la construction sociale des savoirs d'une classe coopérative, différents degrés et nuances dans ce phénomène d'imitation qui, sans atteindre l'idéal, ne sont pas négligeables parce qu'ils sont des facteurs déclenchants de l'activité de l'enfant. Ainsi, s'il est vrai que la reproduction absolue d'une action ( concept pris ici au sens large c'est - à - dire incluant les activités mentales) nécessite de la part de l'individu observation attentive et analyse, même la reproduction incomplète ou imparfaite, parce que la saisie des données n'a pas été totale, peut être à l'origine d'une reconstruction personnelle avec une variance intéressante car source d'hypothèses nouvelles.
Enfin, dans le fonctionnement coopératif, il faut ajouter que l'imitation, processus interactif, toujours présente par l'une de ses formes variées, a une double fonction : "elle est à la fois un instrument d'acquisition et un moyen de relation - communication (2)... permettant aux individus d'accéder à la culture des différents groupes sociaux".
Montage réalisé par E. Lèmery
(1) C. Freinet - Oeuvres pédagogiques - Tome I - Essai de psychologie sensible - p. 375 / 378 - Seuil
(2) A. Weil - Barais - L'Homme cognitif - Chap. XXII - p.461 / 466 - PUF
Auteur :