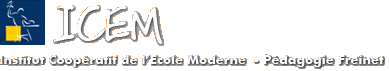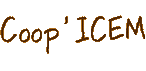Dans : Formation et recherche › Formation et recherche ›
Novembre 1996
Recherche ouverture
De l’éthologie à l’humain, quelle place pour l’affectivité ?
Impromptu de Boris Cyrulnik
Lors de la mise au point du livre-cassette n° 11 (PEMF) « L’homme et l’animal, l’unité du vivant », Boris Cyrulnik avait répondu à quelques questions concernant l’affectivité et l’état de ses recherches sur cette composante capitale de notre personnalité et de notre compétence. Cette réponse rapide ne prétend pas être un article structuré et signé, (on se reportera avec intérêt à ses livres récents - voir bibliographie). Des rapprochements avec ce que Freinet nous avait dit commencent maintenant à s’affiner mais ne sont pas encore banalisés.
« On s’aperçoit de plus en plus que l’affectivité est une partie importante de notre pédagogie. Nous ne devons pas penser que l’individu n’est que connaissances, leçons, devoirs, mais qu’il est aussi une personne sensible et que cette sensibilité a toujours une grande résonance sur son propre comportement et pour le comportement de la masse de la société dans laquelle un individu travaille. »
« On imagine mal la répercussion, pour ainsi dire psychique, de tous les échanges interscolaires : les textes, les lettres collectives, les lettres individuelles, les albums, les photos, les bandes magnétiques. Tous nos envois sont affectifs et ils doivent être affectifs. Toutes nos techniques sont émouvantes par cette affectivité. Il y a même de l’affectivité dans les mathématiques... Vous souriez ?... Oui, je suis certain que l’affectivité joue un rôle dans l’apprentissage et les résultats en mathématiques...» C. Freinet (1958).
Nous sommes partis du constat que la majorité de nos concitoyens ne considère pas l’affectivité comme quelque chose de sérieux puisque les grandes références du public sont surtout la presse du cœur, les journaux féminins, etc. Aussi depuis dix ans, nous avons réuni au moins une centaine de thèses et travaux de recherche, sur l’attachement. Maintenant, nous mettons en chantier, les « carences affectives ».
RECHERCHES-OUVERTURE
On constate que l’essentiel de notre biographie se fait dans l’affectivité. L’hypothèse que nous nous posons c’est que, peut-être, l’intelligence, le traitement des problèmes abstraits et même les lois générales sont, en fait, très enracinés dans l’affectivité, que l’affectivité organise notre société et probablement même notre QI !
En éthologie, on raisonne sur le vivant. D’un point de vue philosophique, l’animal n’est ni plante ni homme, on observe l’un et l’autre cliniquement, on les manipule alors que c’est très difficile de faire de même pour l’homme.
Lorentz et l’objet d’empreinte
Lorentz a observé des canetons : il a dormi vingt-quatre heures auprès d’eux et quand il s’est levé, les canetons suivaient ses chaussures et ne suivaient pas la cane. Rapportés à leur mère, les canetons piaillaient et une espèce de contagion d’angoisse s’emparait d’eux. Celle-ci cessait dès qu’ils retrouvaient les chaussures de Lorentz.
Poursuivant ses recherches, Lorentz a mis des canetons naissants en présence d’un « leurre » qui circule. De 0 à 13 heures après la naissance, la réponse est aléatoire donc non significative. Entre 13 et 16 heures, quand le leurre se déplace, 90 % des canetons le suivent. Quand le leurre s’arrête, ils s’arrêtent. Quand le leurre accélère, ils accélèrent.
Après la 17è heure, le pourcentage chute très rapidement et la réponse redevient aléatoire vers la 25è heure de vie des canetons. Lorentz conclut qu’il faut donc admettre qu’il y a un moment privilégié où le caneton possède une aptitude biologique particulière à cet apprentissage. Quel peut bien être le socle biologique à cette aptitude d’apprentissage ?
Grâce à un produit biologique, nous avons supprimé ce socle, c’est-à-dire l’enzyme de la mémoire qui lui correspond et effectivement, dans ces conditions, le caneton ne peut plus s’attacher et apprendre son monde.
De même, on s’est rendu compte que c’est au moment du sommeil paradoxal, lorsque l’organisme est en pleine décontraction et que le cerveau est en pleine alerte, que se produit ce phénomène.
Apprentissage et sommeil paradoxal
Rappelons rapidement comment notre sommeil se structure. Malgré des différences de durée propres à chaque individu, on distingue quatre ou cinq cycles de deux heures environ qui se composent chacun de plusieurs stades : sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Le stade du sommeil paradoxal de chaque cycle joue un rôle particulier, surtout le dernier de la nuit, qui précède directement le réveil naturel définitif.
Que se passe-t-il si l’on supprime le sommeil paradoxal ? Il est facile à supprimer grâce à des électrodes pour électroencéphalogramme. Quand « les expérimentés » (chatons, et volontaires humains) sont passés au sommeil paradoxal, on les secoue ou on leur administre une substance afin de supprimer ce sommeil paradoxal.
La conclusion de cette expérimentation c’est que l’on perturbe beaucoup l’expérimenté. Ainsi, quand on demande aux enfants de se lever tôt pour aller à l’école on leur supprime la cinquième phase de sommeil paradoxal (cinq phases pendant la nuit). On les envoie à l’école pour apprendre et lorsqu’ils arrivent, ils
ont sommeil et ne peuvent pas apprendre !
Notre société a organisé des rythmes scolaires qui perturbent les mécanismes d’apprentissage.
C’est encore plus grave pour les garçons qui sont biologiquement et psychologiquement moins précoces que les filles.
L’affectivité
Notre condition humaine n’est pas faite que de biologie, c’est Spitz, pendant la guerre 39/45 qui a été un des premiers a parler des « affects » (après Freud !)
Pendant la guerre, de nombreux enfants se sont retrouvés séparés de leurs parents provisoirement ou définitivement et, à notre époque moderne, on voit se multiplier le nombre d’enfants en isolement social et affectif important. Nous avons pu en observer les conséquences comportementales et biologiques.
Dans un premier temps, l’enfant proteste, se désespère ; dans un deuxième, il développe des activités autocentrées comme sucer son pouce, se balancer, se masturber ; dans un troisième temps, il devient
indifférent-affectif, c’est-à-dire qu’il ne répond plus à aucune sollicitation, ne mange plus, ne boit plus, ne sourit plus. Il reste sur le dos, les yeux fixés au plafond. Il peut aller jusqu’à se laisser mourir de faim et de soif si quelqu’un ne lui donne pas à manger ou à boire. Sa dépendance est absolue. Ce ne sont pas les conditions matérielles qui importent c’est l’affectivité.
Un « nourrisson », comme son nom l’indique se « nourrit », mais en fait, il se nourrit davantage d’affectif que d’aliments.
Si le biologique trouble le comportement psychologique, l’affectivité modifie la biologie. On rencontre des enfants de tous âges en carence affective. Cela peut se traduire par un retard de langage, un arrêt des apprentissages scolaires, une régression comporte-mentale, une énurésie, et même parfois des troubles de la marche ou des déformations articulaires. Lorsque la mesure du quotient intellectuel était en vogue, on constatait chez ce type d’enfants des baisses du QI, preuve que celui-ci n’est pas héréditaire comme on l’a longtemps cru ! Il dépend plus sûrement des conditions d’existence et des conditions d’apprentissage.
La mère est avant tout une fournisseuse d’informations sensorielles et celle-ci ne devient une personne
à part entière qu’après l’adolescence, quand l’enfant a terminé sa maturation.
La naissance du sens
Lors de nos expérimentations plus dirigées, nous avons observé l’apparition du pointé de l’index.
Avant le quinzième mois, l’enfant tend la main vers l’objet qu’il convoite, il échoue, il vocalise, il crie, il se jette en arrière, il se tape, il se mord, il présente une hypertonie, une hypergestualité. Vers le quinzième mois, un changement brutal de scénario s’opère : il pointe du doigt vers l’objet convoité, il regarde la mère et il tente de vocaliser un protomot qui se réfère à l’objet désigné. Dès l’instant où apparaît la parole, l’hypergestualité disparaît, le mot remplace le geste. L’affectivité peut passer par le canal verbal au lieu de passer par les cris et les coups. Les petites filles mettent cette attitude au point, à peu près vers douze mois, alors que les garçons n’y accèdent que vers quinze mois. Donc, une vitesse de maturation étonnamment différente selon les sexes.
Chez les enfants en carence affective, on s’aperçoit que le « pointé du doigt » n’apparaît pas.
A l’âge scolaire, les enfants privés de mère pour toutes sortes de raisons, montrent une baisse rapide
des résultats scolaires et la première à chuter, c’est la science des lois générales, les mathématiques.
D’après notre méthode d’observation, on peut proposer que les mathématiques s’enracinent dans l’affectivité.
Chez les adolescents, la dépression est très fréquente. Quand cette baisse de l’estime de soi naît pour des raisons souvent inconscientes, elle entraîne un désinvestissement pour le scolaire. Là encore, on peut dire
que les performances s’enracinent dans l’affectif.
Chez un public adulte immigré, on a pu constater des apprentissages rapides de la langue, alors que chez d’autres, l’apprentissage ne se fait jamais. Il y a souvent corrélation entre la sécurité ou l’insécurité affective dans laquelle se trouvent ces personnes. Si elles sont entourées par leur famille, elles ont davantage de chance d’entrer en apprentissage que les autres, isolées même momentanément.
Chez les personnes âgées aussi, on se rend compte que les confusions, l’arrêt des abstractions surviennent après un choc affectif.
Et s’il y a pléthore affective ?
A contrario, un autre groupe de chercheurs travaille sur les pléthores affectives. Notre société a peut-être inventé cette curieuse pathologie. Les enfants qui relèvent de cette pathologie n’ont aucun désir, alors ils ne se musclent pas, ne se développent pas. Tout est à leur disposition. Il n’y a pas à désirer, pas à penser, à inventer des théories, des démarches. Ils ont de ce fait de grosses difficultés pour acquérir l’autonomie.
Dans une psychose, où la relation mère enfant est très fusionnelle, on assiste à de gros troubles du développement de l’intelligence. C’est ce que l’on appelle des débilités affectives : ces enfants ne peuvent rien apprendre. Nous avons recensé des cas, dans cette catégorie de population, où les enfants présentent des difficultés d’accès au langage mais qui, par contre, sont surdoués en mathématiques. C’est un mode particulier de développement, probablement neuro-affectif, beaucoup plus que neurologique. Avec le développement des scanners et de la résonance magnétique, nous avons vu des gens réaliser des performances mathématiques extra-ordinaires pratiquement sans cerveau. Cela pose un problème neurologique assez inouï. Peut-être l’apprentissage des mathématiques se passe-t-il dans le liquide céphalo-rachidien, autour de la tête ?
Un « dimorphisme » sexuel ?
On dit souvent, on écrit, il est même prouvé scientifiquement, que les filles possèdent un sens mathématique nettement moins aigu que les garçons, or, le propre d’une preuve scientifique c’est d’être momentané !
Après et grâce à de nombreuses observations cliniques, biologiques, comportementales et psychologiques, il s’avère que les filles se développent plus vite que les garçons mais on n’a aucune explication causale ni hypothèse explicative.
Ce que l’on a pu constater (par exemple, que les filles accèdent plus tôt au langage que les garçons, qu’il y a davantage de candidats garçons aux concours de mathématiques, etc.) tient plus d’un phénomène socioculturel ou sociosexuel que d’une réalité biologique. Il faut tenir compte de tous les déterminants.
Le biologiste trouve forcément un déterminant biologique, le neurologue, un déterminant neurologique, le sociologue, un déterminant sociologique... L’ennui, c’est de dire que l’on a « la vérité ». Nous ne sommes plus alors dans une démarche scientifique mais dans une démarche idéologique. La différence entre les garçons et les filles se situe autant sur le plan biologique que sur le plan culturel.
Ontogenèse des rôles sociosexuels
Beaucoup de travaux ont été réalisés dans ce domaine. Ils ont pu démonter que dès les premiers mois de la vie, les apprentissages sont très différents. On se développe déjà de manière très différente si l’on est garçon ou fille. Les mères observées se comportaient différemment avec une fille ou un garçon. Ainsi, nous avons observé la première prise en paume après la naissance, au moment du toilettage du bébé. Chaque manipulation était notée d’une croix ; une croix pour l’index, deux croix pour la paume, trois, pour le corps à corps. Les baisers étaient également notés. Nous avons pu constater que les endroits du corps touchés pendant la toilette étaient très différents suivant le sexe du bébé. Ainsi, les garçons étaient touchés sous les aisselles, derrière la nuque, très peu sur la partie inférieure du corps, surtout pas les fesses et le sexe. Les petites filles étaient touchées sur tout le corps et notamment sur le ventre, les fesses, au milieu du dos. Ces
observations ont été filmées, dans différentes régions de France et se sont confirmées partout.
Des films réalisés en Afrique et aux Indes, ont montré des mères africaines qui empaument leurs bébés garçons à plein sexe. Il n’y a pas de tabou du sexe dans les civilisations indiennes ou africaines.
Les psychanalystes et les biologistes nous ont appris que la manipulation du bébé modifie beaucoup ses développements. C’est peut-être le début d’une explication. Le cerveau, le développement et la biologie évoluent différemment suivant la manipulation. Les hormones de croissance ne sont pas les mêmes, ni
l’architecturation du sommeil, ni la perception sensorielle du monde.
C’est donc le cerveau qui subit la conséquence de la manipulation.
L’école
Elle réalise le meilleur prototype expérimental du développement de l’angoisse. Un apprentissage très complexe, celui du langage, se produit en dehors de toute méthode « scolaire ». Du vingtième au trentième mois, les enfants apprennent l’accent avant les mots. Ensuite ils mémorisent les mots, la syntaxe, les règles et les exceptions, en dix mois environ.
Regardez le temps qu’il faut pour apprendre l’anglais, une fois passée cette période sensible !
On pense qu’il y a effectivement des périodes particulièrement sensibles pour les différents apprentissages.
L’école répond-elle à ces périodes ? Il est certain qu’elle est un milieu expérimental organisé pour développer l’angoisse.
Nous utilisons trois tranquillisants naturels pour conjurer celle-ci : le premier c’est l’action, bouger, courir, attaquer, se confronter aux problèmes... Le deuxième, c’est mentaliser, chercher à comprendre, observer l’agresseur et voir comment se présente le problème... Enfin, le troisième c’est l’affection, la sécurité affective...
Enregistrement et montage : Pierre Guérin et Madeleine Guérin-Génestier, mise au net : Anne Valin et Joël Blanchard.
Bibliographie :
– L’Homme et l’Animal, l’unité du vivant, Livre-cassette n° 11, Éditions PEMF.
– Sous le signe du lien, Hachette Pluriel.
– Mémoire de singe et Paroles d’homme, Hachette Pluriel.
– La Naissance du sens, Hachette La Villette (Questions de sciences).
Auteur :