L'Educateur n°4 - année 1954-1955
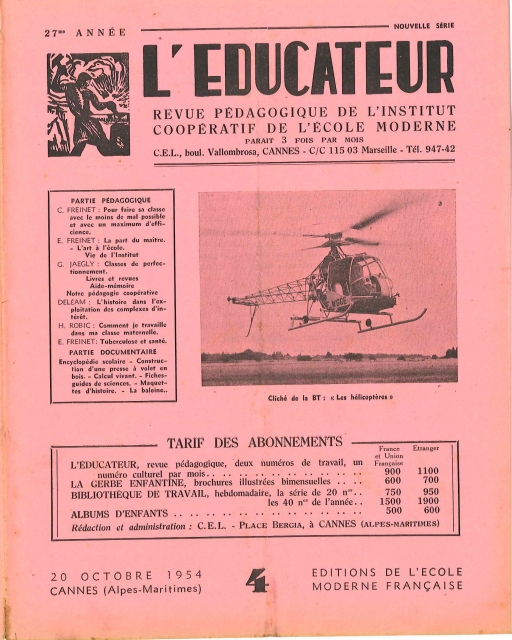
DITS DE MATHIEU - Pourquoi travailler?
— Pourquoi travailler ? pourrait vous dire candidement l'enfant d' aujourd'hui
J'ouvre un journal, ou mon Mickey : partout des aventures, du sport, des compétitions, des discussions qu'on dit philosophiques. Mais qui donc travaille d'ans ce monde sinon les malheureux qui y sont condamnés ?
Je pars en ville : les devantures parient partout de luxe, de fanfreluches et de jouets. Les instruments de travail se cachent pudiquement dans les rues excentriques comme s'ils avaient à se faire pardonner leur présence de pauvres dans une société de parvenus qui rougissent de leurs origines.
Et l'Ecole ne connaît que des devoirs et des leçons qui sont pour nous ce que la machine est pour nos pères, un asservissement dont on se dégage dès qu'on en a la possibilité. Seuls les jeux nous enthousiasment et nous font oublier les exigences inhumaines du travail.
Le monde, pour nous, l'essentiel de ce qu'il nous offre ou nous impose, ce sont le ballon, les soldats de plomb, les collections d'images et nos journaux illustrés... sans compter le cinéma toutes les fois que nous pouvons y entrer.
Travailler ! Si je prends, un jour, clandestinement la pelle du maçon, la bêche ou la brouette du jardinier, le marteau ou les pinces de mon père, on me poursuit comme si j'avais commis un crime. Creuser des grottes, bâtir des châteaux, préparer un semis, dresser des barrages, fouiller les ruisseaux, monter et démonter des machines seraient pour moi les plus passionnantes des occupations, à tel point que j'en oublierais Mickey ou le cinéma. Ce sont, hélas ! des fruits défendus : il parait que nous salissons nos habits, écorchons nos doigts ou nos jambes, égarons les outils... Alors on nous renvoie à ce qu'on appelle ensuite des futilités.
Le travail, pour nous, conclurait cet enfant, c'est la malédiction : c'est l'outil qui salit les mains, l'usine qui ronge notre vie, l'esclavage qui nous déshonore.
Seul le jeu nous épanouit et nous libère. Voyez ses vedettes.
Et nous pourrions, en effet, faire notre mea culpa, en reconnaissant qu'il y a maldonne dans les principes mêmes de notre éducation, et que c'est d'abord par le travail qu'on prépare au travail dans une école et dans une société du travail.
Guide général de l'Ecole Moderne
Tel est notre but ; telle a été la raison majeure qui nous a fait, à l'Ecole Moderne, nous rencontrer pour chercher ensemble, pour essayer, créer, bâtir, expérimenter, éditer...
Trente ans de cette besogne complexe et enthousiasmante, dans des milliers d'écoles, avec des millions d'enfants, cela laisse évidemment une trace, qui est notre commune richesse. Cette trace, nous l'avons tous plus ou moins diffuse en nous, et c'est grâce aux possibilités nouvelles qu'elle nous vaut que nous faisons mieux notre classe, et avec moins de peine que si nous étions noyés encore dans les méthodes traditionnelles. Et c'est pourquoi nul d'entre nous ne voudrait revenir aux pratiques d'un passé dont il a gardé un souvenir suffocant. Les Inspecteurs eux-mêmes, et les parents, reconnaissent aujourd'hui les avantages psychologiques, pédagogiques et humains des Techniques Freinet de l'Ecole Moderne, et c'est pour nous comme une justification encourageante de la portée de nos efforts.
Si nos techniques — et nous nous en réjouissons — sont largement adaptées aux classes et aux milieux divers où nous nous trouvons plongés ; si chacun de nos adhérents emploie d'une façon originale — que nous nous appliquons à faire connaître ici — les outils que nous avons mis au point, et dont nous avons révélé l'efficacité, il n'en reste pas moins que notre longue expérience a permis, à ce jour, pour l'ensemble de nos adhérents, un comportement de base qui est la marque des éducateurs et des écoles modernes.
Bien que la chose apparaisse comme bien délicate, nous allons commencer ici un GUIDE GENERAL POUR L'EDUCATEUR MODERNE, qui définira et fixera cet acquis de base, que chacun aura mission ensuite d'adapter et d'enrichir selon les conditions particulières de son école. Pour ce travail, dont vous comprenez tous l'importance et qui sera comme le point de trente années d'efforts coopératifs, nous attendons la critique permanente et la collaboration de tous nos camarades. Nous voudrions surtout que les jeunes s'interrogent, et nous interrogent, pour que nous puissions, chemin faisant, améliorer et compléter des notes qui restent, malgré tout, comme un condensé et un résumé.
Le laboureur s'arrête de temps en temps, au bout du sillon, pour souffler, certes, mais aussi pour contempler un instant le travail accompli, pour mesurer les faiblesses et tâcher de les corriger, pour reprendre courage aussi au spectacle réconfortant de la terre grasse que la charrue a soulevée et qui semble porter en elle, déjà, toute la promesse des moissons attendues.
Nous contemplons, nous aussi, un instant, le vaste terrain, si divers, où, à travers les pays, des milliers d'écoles s'appliquent à faire briller un peu de soleil.
Et, déjà, nous avons repris la charrue, car la vie ne saurait attendre.
I. — UNE ATTITUDE EXPÉRIMENTALE :
D'abord, ne prenez jamais cette attitude étroite et sectaire de celui qui n'aurait plus rien à apprendre. On vous appelle « le maître ». C'est un grand honneur, et une lourde responsabilité. Mais le maître n'est pas le chef qui essaie d'en imposer en se disant supérieur en tout, en prétendant tout connaître, et en se montrant, en face des insuffisances des enfants et des adultes, d'une sévérité — pour les autres — qui nous ferait sourire.
Le « maître », c'est celui qui sait le mieux organiser, animer et diriger le travail de ceux qui reconnaissaient en lui une richesse et une force.
Vous avez entendu parler des Techniques Freinet. Vous haussez les épaules et vous justifiez votre opposition en donnant des arguments que vous avez entendu exprimer par des gens qui n'en savaient pas plus long que vous, et qui, eux aussi, avaient entendu dire...
Essayez donc de voir de près, par vous-mêmes. Méfiez-vous, en général, des personnes qui vantent, avec beaucoup de flamme une machine ou un procédé. Ce sont peut-être, sous une forme ou sous une autre, des commis-voyageurs. Mais allez donc visiter une classe travaillant selon les Techniques Freinet, assistez à un Congrès ou à un Stage de l'Ecole Moderne ; écoutez un instituteur qui vous dira simplement, à même son travail, les avantages et les inconvénients aussi des techniques qu'il a lentement, mais efficacement, introduites dans sa classe.
Cette attitude expérimentale nous ne vous la recommandons pas seulement pour les Techniques Freinet, mais aussi pour toutes les méthodes, pour toutes les attitudes que vous aurez à juger et à apprécier.
J'ai écrit, il y a quelques années, un Dit de Mathieu qu'il n'est pas inutile, je crois, d'inclure dans la série de ces conseils :
CEUX QUI FONT ENCORE DES EXPÉRIENCES
Il y a, dans la vie, deux sortes d'individus : ceux qui font encore des expériences et ceux qui n'en font plus.
Ils n'en font plus parce qu'ils se sont assis au bord de la mare à l'eau dormante, dont la mousse a effacé jusqu'à la limpidité et jusqu'au pouvoir qu'ont parfois les mares de changer de couleurs selon les caprices du ciel qu'elles reflètent. Ils se sont appliqués à définir les règles de l'eau morte, et ils jugent désordonnée, incongrue et prétentieuse l'impétuosité du torrent troublant l'eau de la mare, ou le vent qui balaie un instant vers les bords les mousses stagnantes, redonnant un court reflet de profondeur azurée à la nappe verdâtre.
Ils ne font plus d'expériences parce que leurs jambes lasses ont perdu jusqu'au souvenir de la montagne qu'ils escaladaient naguère avec une audace qui triomphait parce qu'elle allait toujours au-delà des ordonnances et des prescriptions de ceux qui s'appliquent à réglementer l'ascension au lieu de la vivre. Ils se sont confortablement installés dans la plaine toute marquetée de routes et de barrières et ils prétendent juger selon leur mesure à eux la hardiesse des montagnes dont les aiguilles semblent défier l'azur.
Ils ne font plus d'expériences. Alors, ils voudraient arrêter la marche de ceux qui risquent de les dépasser et de les surclasser. Ils essaient de retenir les inquiets et les insatisfaits qui grondent avec le torrent ou qui partent par des voies inexplorées, à l'assaut des pics inaccessibles. Ils codifient sur leurs grimoires les lois de la mare morte ou de la plaine marquetée et ils condamnent d'avance, au nom d'une science dont ils se font les grands maîtres, toutes les expériences qui visent à sonder ce qui reste encore d'inconnu, à découvrir des voies hors des routes traditionnelles, et à tenter chaque jour l'impossible parce que c'est cet incessant assaut de l'homme contre l'impossible et l'inconnu qui est la raison vivante de la science.
Il y a deux sortes d'hommes : ceux qui font des expériences et ceux qui n'en font plus. Il faut hélas ! en ajouter une troisième : celle des malfaiteurs qui ne craignent pas de bondir avec le torrent ou d'escalader les pics avec les intrépides, mais dans le seul souci de s'approprier, pour les exploiter à leur profit, les découvertes désintéressées des éternels perceurs d'ombre, des chasseurs de vérité, des créateurs de justice, de lumière et de beauté.
Avec notre idéal, ils font Hiroshima. Jusqu'au jour où nous leur barrerons la route pour reconquérir la vraie science, dynamique et humaine, que nous faisons tous ensemble, avec nos muscles, avec notre cœur, avec notre volonté et avec notre sang.
II. — UNE ATTITUDE LOYALE :
Loyale vis-à-vis de vous-même plus encore que vis-à-vis des autres.
Ce sont les faibles qui se bouchent les yeux et se masquent les problèmes pour ne pas avoir à les affronter. Mais vous êtes des « courageux » ou vous ne serez pas des « maîtres ».
Il faut d'abord, si vous voulez progresser — tant au point de vue pédagogique qu'au point de vue social et humain — vous appliquer à bien situer les problèmes, en en posant les données comme vous posez les équations dans un calcul ; en ne craignant pas, le cas échéant, de reconnaître qu'on a peut-être suivi une fausse piste qui aboutit à une impasse. Et vous reprendrez, s'il le faut, un autre chemin.
Ne vous obstinez pas, au nom d'un amour-propre qu'il vous faut dominer, à faire valoir des comportements et des méthodes dont vous sentez pourtant les imperfections et les insuffisances. Tâchez de détecter loyalement, froidement ces insuffisances ; recherchez pourquoi vous n'avez pas encore pu corriger ces imperfections. Etablissez une équation implacable que vous vous appliquerez à résoudre.
Nos techniques ne doivent pas être épargnées dans cette reconsidération permanente de nos principes de vie. Aucun d'entre nous ne saurait prétendre à la perfection dans sa classe. S'il n'atteint pas à la perfection, c'est donc qu'il a des faiblesses et qu'il commet des erreurs. C'est notre lot à tous. Vous ne vous abaissez point en reconnaissant cet état de fait. Vous vous grandirez, au contraire, parce qu'une des premières conditions pour corriger une insuffisance, c'est d'en prendre délibérément conscience. Détecter l'erreur est la démarche élémentaire à tout progrès.
Ne vous cramponnez jamais à une information, à une attitude, à une opinion ou à une méthode. La vie évolue tous les jours. Quiconque se vante de ne pas changer se fossilise. Ne craignez jamais d'ajuster votre jugement ou votre comportement aux données majeures de votre expérience. Soyez loyal avec vous-même, quoi qu'il vous en coûte. Efforcez-vous ensuite d'être loyal également, dans l'examen objectif des divers problèmes, avec ceux qui collaborent avec vous.
C'est parce que nous avons ainsi reconsidéré sans cesse tous les problèmes que nos techniques restent, après trente ans, aussi neuves et aussi dynamiques qu'en 1925.
Entraînez-vous à l'expérience loyale. C'est plus difficile qu'on ne croit car nous nous heurtons toujours à ce brin d'amour-propre qui est le paravent menteur de ceux qui ne font plus d'expériences.
III. — UNE ATTITUDE COURAGEUSE :
Les gens n'aiment pas être dérangés, et nous-mêmes n'échappons qu'à grand-peine à cette loi.
On dit bien que les méthodes traditionnelles sont défectueuses, insuffisantes, peut - être dangereuses. Elles sont comme ces vieux chemins où l'on passe depuis toujours, dont on a pris l'habitude et dont on s'accommode tant bien que mal : si vous voulez vous faire des ennemis, tracez une nouvelle route...
Nous pourrions presque dire comme Jésus : « Je n'apporte pas la paix... »
Vous aurez contre vous certains collègues qui ne veulent pas entreprendre ce même effort de régénération et que dérange votre dynamisme. L'Inspecteur trouvera peut-être, au début, que son travail de contrôle en est compliqué. Et vous rencontrerez des parents assez butés pour s'opposer à ce que leurs fils suivent d'autres voies que celles dont ils disent pourtant, à longueur de soirées, toute la malfaisance.
Il faut que vous sachiez cela d'avance, pour y parer le cas échéant. Mais vous vous souviendrez aussi que, toujours, le courage paie.
IV. — UNE ATTITUDE HUMAINE :
On dit la scolastique « dogmatique », c'est-à-dire opposée aux enseignements de l'expérience, parce qu'elle est fermée, froide et inhumaine, par la pratique de formules enseignées et apprises, qu'on a perdu l'habitude de discuter; ou qu'on croit ne pas pouvoir discuter parce qu'elles sont systématiquement coupées des vrais problèmes de la vie.
Si, en vous dégageant courageusement de l'emprise d'une scolastique qui vous a parfois irrémédiablement marqués, vous prenez l'habitude de reconsidérer votre comportement à la lumière de votre expérience loyale, vous deviendrez plus indulgents dans la pratique de la vie avec vos collègues, avec les parents, avec vos élèves.
Vous sentirez ce changement d'attitude dès que vous entrerez dans une classe moderne : vous entendrez l'instituteur parler de sa voix humaine, les enfants interroger et discuter humainement, et vous verrez se normaliser les rapports entre éducateurs, enfants et milieu. Et vous comprendrez que c'est ce changement d'attitude qui est à la base de l'esprit nouveau de l'Ecole Moderne.
Informez-vous, expérimentez loyalement, courageusement et humainement, à même votre travail. , Vous reconsidérerez votre propre culture et redonnerez à votre fonction d'éducateur tout son sens d'éveilleurs et de conducteurs d'âmes.
Quelle est la part du maître? Quelle est la part de l'enfant?
Oui, le rêve est bien nécessaire : Jusque dans nos existences les plus positives, jusque dans nos obligations matérielles les plus implacables, il chevauche notre raison et affine les gestes précis de nos doigts. Il faut avoir rêvé sa spiritualité ou son rationalisme, son simple problème ou son émouvant poème pour leur donner l'ordonnance de l'austère logique ou le rythme nuancé du noble style. Il faut avoir rêvé sa « belle ouvrage » avant de la saisir par le bon biais pour la mener rondement de toute l'ampleur de ses bras et par l'effet d'un bon vouloir inépuisable. Il faut avoir rêvé son bonheur avant de le sentir vivre en soi, de s'en rendre maître pour le dispenser autour du monde, toujours nouveau et toujours renaissant. Il faut avoir rêvé l'enfantelet qui va naître pour l'accueillir dans son berceau riche de tant d'amour et embelli de toutes les illusions des jeunes mères. Il faut avoir rêvé une belle œuvre pour y consacrer sa vie entière sans découragement ni défaillance, malgré l'incompréhension et l'injustice des hommes. Il faut avoir rêvé de l'insondable éternité de l'au-delà pour nous trouver, à l'instant de la mort, à la hauteur de Dieu ou à celle du Néant à la froide immobilité libératrice.
Heureux ceux qui savent rêver ! Lire du dedans ce qui est image du présent et de l'avenir ! Rattacher le passé à l'aventure quotidienne déjà engagée dans des lendemains plus somptueux !
Heureux ceux qui savent rêver !
Heureux entre tous l'enfant de tous les jours pour qui le rêve est une manière d'exister !
Oui, mais il y a le danger de la rêverie.
Bon gré, mal gré il faut s'adapter à ce monde atrocement mécanisé où l'homme devient matériau de la tyrannique production technicienne ou rouage de l'appareil administratif caporalisé, vassalisé qui régente tout. Ou il s'intègre, ou il disparaît et pour s'intégrer il faut se raidir et lutter, les pieds bien posés sur la terre, l'esprit tendu et toujours en éveil. Au bon moment, il faut savoir saisir le levier de commande, le tenir ferme et foncer en avant, et tant pis si l'on doit, dans ces compétitions inexorables, écraser quelqu'un sur son passage, fut-il le meilleur ami. Le succès est à ce prix et de plus en plus il obsède l'esprit de nos jeunes garçons et de nos jeunes filles : succès confortable de l'argent si facilement gagné par les vedettes consacrées (on ne sait trop souvent pourquoi !); succès honorifique d'une belle situation enviée ; succès grisant d'une renommée bien assise...
Sans nul doute, pour en arriver là, il faut savoir jouer serré du cerveau et des coudes et plus encore, peut-être, du genou, car la génuflexion a, de tous temps, été un exercice qui paye...
Reste cependant qu'il est de grands écrivains et de grands musiciens et des artistes et des poètes et aussi des romanichels, des saltimbanques et des chemineaux, et des amants et des parents comblés, et de paisibles aïeules, et des petits-enfants qui sont accrochés à leurs plus belles joies et qui se nourrissent de leur rayonnement comme si les habitait une vue du dedans plus réelle que celle de leur rétine. De leurs effusions intérieures sort toujours une réalité plus haute, venue de loin dans la vie des choses et qui, comme en se jouant, nous ouvre des seuils interdits. Le prodige est qu'ils soient si intensément eux-mêmes dans une solitude qui les recrée au lieu de les dissocier et qu'ils s'en libèrent si aisément pour nous toucher et nous donner la grâce. Par nous, ils sont prolongés et multipliés et, par eux, nous sommes agrandis de tout leur insondable pouvoir de libération !
Eh ! bien, de tout cela, on peut faire quelque chose : Eux qui donnent et nous qui recevons, nous savons faire alliance pour aller un peu plus loin que nous ne pensions aller. Et nous savons que c'est par la découverte qui nous vient d'eux que, toujours, nous serons élargis. Alors, nous voulons ici faire confiance aux créateurs de rêve, certains que nous sommes d'être embellis et comblés chaque fois que nous aurons été participants de leurs délivrances qui, si aisément, délieront les chaînes de nos limitations et de nos emprisonnements.
Comme toujours, nous remonterons aux sources. Nous solliciterons du Récitant, cette fonction de rêverie qui est pour lui thème central et nous tâcherons de nous en saisir pour qu'elle devienne élément d'une vérité nouvelle, mais toujours œuvre vive que nous partagerons avec le plus grand nombre.
Anne-Marie, la petite allongée, n'a devant elle que le mur délavé de la grande cuisine humide. C'est un horizon bien triste et trop significatif de limitation et de pauvreté. La pellicule de chaux en est, par endroit, détachée, laissant apparaître la teinte brune et sale de la vieille demeure paysanne qui fit si rarement peau neuve au cours d'un passé déjà séculaire. L'humidité a fait surgir çà et là des taches dispersées qui, par endroit, se chevauchent en camaïeu.
— Maman, a dit, un jour, Anne-Marie, je vois le chien et le berger.
— Mais où ? a dit maman, inquiète.
— Là, sur le mur. Je l'ai cherché longtemps le pantalon du berger, mais maintenant, je l'ai trouvé. C'est dommage qu'il n'ait qu'un soulier. Mais ça se peut qu'un berger ait perdu un soulier. Il marchera avec un pied nu, voilà tout... Le chien, lui, il a ses quatre pattes, en entier.
— Mais non, ma petite fille, il n'y a pas de berger ni de chien sur le mur. Les chiens et les bergers marchent par terre. Allonge-toi et reste sage !
— Mais si, maman, sur le mur, je le vois le chien et aussi le berger. Regarde mon doigt et bien juste au bout, c'est la tête du chien avec ses oreilles noires et son museau un peu marron, un peu jaune...
Jour après jour, par l'effet d'une angélique patience qui n'avait pour trame qu'une rêverie d'enfant, tout un troupeau se leva sur le mur délavé : le troupeau du silence, où le mouton et la chèvre, l'âne et la vache s'immobilisaient, hiératiques et mystérieux, dans un monde élémentaire de genèse. Et à tâtons, sous le front illuminé d'Anne-Marie, se déroulait la fantastique histoire de ce cortège de bêtes fantômes que la maman ne savait voir et que la fillette voyait glisser et s'ébattre dans une prairie de rêve ; une prairie qui n'était pourtant que la simple muraille ravinée de la plus humble des demeures.
(à suivre.) Elise Freinet,
L'art à l'école
En ce début d'année scolaire, notre premier souci a été de faire le maximum pour nos écoles modernes encore débutantes dans la vaste expérience d'art enfantin ou encore mal dégagées de l'emprise d'un classicisme de rabais. Nous avons précisé pour toutes ces écoles ce que nous allions faire, tout de suite, pour les aider. Elles n'ont désormais qu'à se reporter aux instructions données dans les Nos 1 et 2 de notre «Éducateur» 1954 pour prendre contact avec nous et démarrer hardiment vers l'expression artistique.
Un destin plus ample attend nos écoles-artistes, celles qui peuvent désormais continuer dans le succès et le murissement, l'œuvre déjà conséquente de leur expérience. Depuis quelques années ces écoles-artistes ont donné à toutes les manifestations locales ou nationales, un cachet, une valeur, une portée qui affirment la permanence de notre acquis dans le domaine de l'Art. Certes, nous ne nous attendons pas, dans le monde pédagogique, à voir nos titres de pionniers et de laborieux travailleurs être reconnus ou tout au moins cités — comme l'exigerait la simple objectivité d'information. Nous ne songeons même pas à nous faire rendre justice quand les cénacles s'emparent de nos biens pour orchestrer leur propre renommée. Demandez donc aux autorités de l'U.N.E.S.C.O. si par hasard elles ont entendu parler des réalisations de l'Ecole Moderne. Et vous aurez une idée très nette de la part qui nous est faite au sein d'une organisation qui se veut internationale et impartialement documentée.
Mais le temps et l'action travaillent pour nous. Le silence n'a jamais jugulé la vie, et la vie ne fleurit que sur les humus fécondés de fortes semences. Personne autant que nous ne sème aussi généreusement aux quatre vents et sans la moindre arrière-pensée de renommée personnelle. Nous laissons à nos camarades une liberté totale de création et d'utilisation de leurs richesses car nous savons que chacun d'eux fera toujours le maximum pour que l'Ecole Moderne et l'Art tout court y trouvent leurs avantages indissolubles. C'est parce que nous savons bien cela que nous allons organiser à Aix-en-Provence, lors de notre grand Congrès annuel, le premier Festival d'Art enfantin. Une telle initiative n'est pas prétentieuse de notre part. Chaque année nos Congrès font la preuve des possibilités inouïes de nos diverses écoles modernes. Nous sommes plutôt encombrés par trop de richesses. De richesses qu'il nous faut désormais passer impitoyablement au feu de la critique pour rejeter les faux reflets du clinquant et le détail facile encore nourri de banalité. Devant des réalisations aussi impressionnantes d'ampleur et de qualité telles que celles qui magnifient tous nos congrès nous pouvons faire confiance au sûr instinct de nos camarades pour tout ce qui touche à l'œuvre d'art. Certes, un maître ignore peut-être pour quelles raisons informulées, il aime tel ou tel tableau réalisé par l'enfant et pourquoi il sait aider à l'éclosion de talents à, peine soupçonnés jusqu'à la réalisation d'une peinture qui brusquement fut un événement : désormais le jeune auteur sera l'objet d'une sollicitude de tous les instants pour que soient préservées et nourries toutes les promesses d'un bon départ, Au demeurant, qu'avons-nous besoin de docte critique pour nous éclairer sur nos propres émotions ? Il est tellement naturel que notre joie nous éclaire de l'intérieur, comme les vrais bonheurs, qui ne peuvent, qui ne doivent pas être formulés sans risques d'être amoindris et ramenés aux limitations des usuels vocables. Certes, nous ne disons pas qu'une solide culture artistique nous serait inutile. Un savoir plus sûr mettrait nos maîtres à l'abri de bien d'hésitations, de choix difficiles et aussi d'illusions douteuses. Mais notre culture ne va-t-elle pas s'élargissant au fur et à mesure que l'habileté et le tour de main personnels de chacun de nos enfants nous obligent à chercher appui auprès des œuvres de grands, maîtres. Car il est indéniable que dans leur inspiration comme dans leur facture nos grands modernes redécouvrent cette franche ingénuité, cette sincérité sans calcul, cet éclat de la couleur simple et vive qui sont l'apanage de l'enfance. Nous avons clans nos œuvres enfantines la possibilité de donner la réplique à Matisse, à Picasso, à Chagall, à Braque, à Brianchon, etc... Et ces grands maîtres ne s'offusquent en aucune façon de ce rapprochement mais y voient au contraire la manifestation d'une vérité d'époque et aussi la certitude d'être compris et aimés par les générations à venir.
Préparons donc sans fausse timidité et sans appréhension notre premier Festival d'Art Enfantin. Il sera grand et beau, nous en sommes certains, et dès maintenant nous allons vous demander de sélectionner les meilleures de vos œuvres en vue de ce grand événement. Il va sans dire que les peintures de valeur qui ont été reconnues comme très méritoires dans nos compétitions passées gardent leur chance de se voir choisir dans ce grand tournoi définitif. Ouvrez vos cartons, faites un choix assez large et le moment venu vous ferez avec toutes vos richesses un bouquet à la gloire de l'enfant-artiste dont il sera le message.
Cette année nous prendrons nos précautions pour n'être pas embouteillés à la clôture de notre concours de dessins, en mars. Nous demanderons à nos écoles-artistes de nous faire leurs envois après janvier de manière à ce que nous puissions faire en toute tranquillité le choix qui s'impose et aussi faire photographier les œuvres choisies en vue de réaliser le film fixe qui donnera pérennité à une telle manifestation.
Mais le dessin d'enfant ne sera pas l'unique manifestation de notre Festival. L'œuvre enfantine est depuis longtemps incorporée à toute la vie de l'enfant par ces travaux d'art si naturels, si émouvants qui font chaque année le charme de notre Maison de l'Enfant dont nous reparlerons.
Un ennui à tous ces projets : nous ne pourrons compter pour ces manifestations sur les belles salles spectaculaires dont nous avons bénéficié à Rouen et à Chalon. Aix est une ville d'intimité citadine. Nous nous adapterons à cet état de fait. Nous en reparlerons dans une prochaine causerie et en attendant de reprendre contact avec vous tous, commençons à penser à notre 1er Festival d'Art Enfantin dans la capitale provençale d'Aix-en-Provence.
(à suivre).
Comment je travaille dans une classe maternelle
Vers une commission de la santé de l'enfant