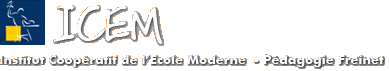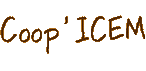Le principe
Le chauffage au sol consiste à faire circuler de l’eau chaude sous le plancher, dans des tuyaux. Les tuyaux doivent être posés sur un isolant et sous une dalle de béton.
La dalle de béton permet à l’eau de ne pas donner directement sa chaleur à l’air mais plutôt de la céder par conduction1 au béton, qui restituera cette chaleur par rayonnement dans la pièce. La chaleur sera ainsi uniformément répartie et les problèmes d’accumulation d’air chaud au plafond seront évités.
L’eau circulant dans les tuyaux ne doit pas dépasser 28°C pour que la température du sol ne soit pas trop élevée et ne crée pas de douleurs dans les jambes.
Le chauffage de l’eau
Nous avons décidé de chauffer l’eau avec une chaudière à bois automatique pour les avantages écologiques de ce système : pas d’émanation à effet de serre car les chaudières permettent une combustion complète ; le bois est un combustible naturel et renouvelable ; la production du bois consomme très peu d'énergie.
• La chaudière à bois automatique
L’alimentation du combustible est automatique (une vis sans fin fournit la chaudière)
La température est régulée automatiquement, comme une chaudière classique.
La chaudière distribue la chaleur à l’eau du plancher chauffant.
Combustible : bois déchiqueté, plaquettes forestières (copeaux entre 2 et 5cm), céréales, noyaux de divers fruits, les coquilles de noix, noisettes et les granulés divers etc…Les combustibles sont stockés sous un abri à côté de la chaudière.
• Le puits canadien
En profondeur, la température du sol est très stable.
Le puits canadien (ou provençal), vieux procédé utilisé dès l’époque romaine, consiste à exploiter, suivant les saisons, la différence de température entre l’air extérieur et le sol en profondeur : en été l’air chaud va se refroidir sous terre, pas besoin de climatisation dévoreuse d’énergie ; en hiver, l’air extérieur va se réchauffer sous terre, permettant une économie de chauffage.
Entrée d’air
Modèle pour le réseau enterré
Pour cela, il faut faire circuler l’air extérieur dans des tuyaux enterrés à 3,50 m, sur une longueur 70 m environ pour notre maison, sur un terrain libre de toute construction (dans le jardin). La prise d'air du puits doit être à l'abri des intempéries (pluie, neige), soit à un mètre minimum du sol, protégée par un grillage des feuilles mortes, des rongeurs, des insectes (moustiques) et par un filtre empêchant l'encrassement du tuyau, et les pollutions éventuelles.2
1 : Intérieur : pièces sèches
2 : Intérieur : pièce humide
3 : Extérieur
4 : Mur extérieur
5 : Plafond et mur intérieur
1 : Entrée d’air
2 : Grillage et filtre
3 : Regard
4 : Siphon
5 : Ventilateur
6 : Ventilateur extracteur (l’air chaud monte et contient beaucoup de vapeur d’eau en été, c’est pourquoi le ventilateur du 1er étage qui n’est pas dans une pièce humide, est indispensable en été, pour évacuer l’air chaud de la maison)
1 : Interrupteur pour enclencher l’extraction en demi-saison
•La ventilation
Lorsque l’on fait entrer de l’air dans une maison, on doit en extraire.
La ventilation simple flux, qui fonctionne en même temps que le puits canadien, extrait l’air des pièces humides pour l’envoyer dehors. Il faut ventiler les logements pour des raisons d’hygiène et pour éviter les dégâts dûs à l’humidité. L’air contient de l’eau sous forme de vapeur, il peut être plus ou moins humide, un air trop sec ou un air trop humide est malsain. C’est pourquoi la ventilation extrait l’air de la salle de bain, des toilettes et de la cuisine qui sont les pièces ayant le plus tendance à être saturées en vapeur d’eau, fait entrer l’air neuf dans les autres pièces (dites sèches).
L’utilisation de l’eau
• Une eau chauffée grâce à des panneaux thermiques
Aujourd’hui, de nombreuses personnes cherchent à faire des économies sur l’eau chaude en trouvant des moyens efficaces de limiter leurs dépenses.
L’eau chaude a un prix assez élevé (exemple : une famille de 4 personnes consomme environ 50 m3 d’eau chaude par an, soit 200 euros/an avec un chauffage au gaz naturel ou au fioul). Or l’énergie solaire est entièrement gratuite et renouvelable à souhait : nous utiliserons des « panneaux solaires thermiques à eau », appelés aussi « chauffe-eau solaires ».
Ils captent environ 60 % de la lumière du soleil, c’est pourquoi il faut généralement les installer sur le toit, et non au rez-de-chaussée ou dans le jardin, car il leur faut une exposition au soleil importante (effectivement, sans soleil, il n’y a plus d’énergie solaire, ce qui risque de poser problème). Ceci implique l’absence d’arbres ou de bâtiments trop élevés à proximité des panneaux : dans les grandes villes, l’utilisation de panneaux solaires est quasiment impossible, du fait que tous les immeubles se surpassent les uns les autres et se font de l’ombre, rendant ainsi nulle la production d’énergie solaire. C’est pourquoi il est obligatoire qu’un particulier ou même un architecte ait besoin d’une approbation administrative pour installer, ou faire installer des panneaux solaires.
Pour notre projet de maison environnementale, nous avons fait le choix de nous placer dans des conditions « idéales », donc nous n’aurons pas de problèmes de voisinage en ce qui concerne les panneaux solaires. De plus, selon l’inclinaison des panneaux thermiques, ceux-ci captent plus ou moins d’énergie, c’est pourquoi il est essentiel de trouver l’inclinaison idéale pour que leur fonctionnement soit maximal. En Aquitaine, région sur laquelle nous avons décidé de nous baser pour notre maison, cette inclinaison « parfaite » est située entre 30° et 32°, nous inclinerons donc nos panneaux thermiques à un angle de 30°.
Fonctionnement des panneaux solaires thermiques
Ils sont composés d’un circuit de tubes auxquels sont rattachés, sur les côtés, de petites ailettes qui vont servir à capter l’énergie solaire. Ces ailettes forment un absorbeur qui va transmettre la chaleur du soleil à un liquide circulant dans les tubes. On dit de ce liquide qu’il est « caloporteur » : c’est un liquide antigel (il ne se figera pas dans les tubes même à très basse température), il ne bout qu’à partir d’une température aux alentours de 150°C (ainsi il n’endommagera pas le circuit de tubes) et il est capable de garder longtemps la chaleur qui lui a été transmise. Ce liquide caloporteur chauffé par l’énergie solaire va ensuite se diriger vers le cumulus (ballon d’eau chaude) grâce à une pompe appelée « circulateur », il va le traverser puis chauffer à son tour l’eau présente dans le cumulus. Ensuite, le liquide caloporteur ayant transmis sa chaleur à l’eau du cumulus se redirige vers les panneaux solaires thermiques, où il sera réchauffé par l’absorbeur, et le cycle se poursuite ainsi de suite. De cette manière, l’eau du cumulus sera chauffée en continu grâce à l’énergie solaire.
En général, les panneaux solaires thermiques chauffent l’eau entre 35°C et 40°C, or nous en avons souvent besoin à 50°C. Pour parvenir à la température voulue, nous pouvons utiliser l’électricité et chauffer un peu plus le liquide caloporteur, pour cela nous installerons un « transformateur » dans le circuit (entre la pompe et le cumulus). Ainsi, au cas où il n’y ait pas d’ensoleillement suffisant, c’est l’électricité qui prend le relais par l’intermédiaire de ce transformateur et qui chauffe, à elle seule, le liquide caloporteur.
Achat et installation de panneaux solaires thermiques
Afin d’encourager les particuliers à faire installer des chauffe-eau solaires (panneaux thermiques) chez eux, des réductions d’impôts sont prévues, voire des aides financières dans certaines régions. Il est important de faire attention à bien respecter ces conditions d’installation, car une bonne installation de panneaux solaires thermiques peut permettre d’économiser jusqu’à 130€/an, ce qui n’est pas négligeable. De plus, 1 m² de panneaux suffit pour subvenir au besoin en eau chaude sanitaire d’une seule personne. Pour notre maison, la famille compte quatre personnes, donc nous mettrons 5 m² de panneaux solaires thermiques (4 m² + 1m² supplémentaire). Cela nous coûterait environ 1 000 € ; ils seraient placés plein Sud, avec une inclinaison de 30° par rapport au sol.
• La récupération des eaux pluviales
C’est un système très utilisé dans les pays du Nord de l’Europe. L’eau de pluie est récupérée sur les toits par des gouttières qui envoient l’eau dans des cuves sous terre ou apparentes. Par une pompe, l’eau est ensuite renvoyée pour alimenter la chasse d’eau des toilettes et un robinet extérieur, pour arroser les plates bandes, la pelouse ou laver la voiture. Nous récupèrerons l’eau de pluie uniquement sur la toiture de l’étage, la terrasse au dessus du rez-de-chaussée étant recouverte de végétation, cela impliquerait un trop gros traitement des eaux pour la nettoyer.
Une famille de 4 personnes consomme, en moyenne, 492 litres d’eau par semaine pour les toilettes (Une chasse d’eau consomme 3 ou 6l, suivant si l’on utilise la fonction économique ou pas). Par calcul, en tenant compte de la moyenne des précipitations par mois à Bordeaux (site de la météorologie), nous avons vérifié que la surface de la toiture était suffisante pour assurer les dépenses de la chasse d’eau ainsi que l’arrosage de la terrasse végétale.
Par calcul, nous avons vérifié que la surface de la toiture était suffisante pour assurer les dépenses de la chasse d'eau, ainsi que l'arrosage de la toiture végétale
Pour notre maison, nous avons choisi d’utiliser 2 cuves, l’une d’1m3 et l’autre de 2m3, afin d’être sûrs que toute l’eau pourra être stockée. De plus la terrasse végétale sera arrosée par l’eau de pluie, la couche de terre étant très mince (15cm), elle s’assèchera extrêmement vite, ce qui implique, en été, un arrosage presque permanent et donc, un stock d’eau conséquent, c’est pourquoi on ne se limite pas à une cuve d’1m3 qui serait suffisante pour les toilettes.
L’eau de pluie est filtrée avant d’être stockée. Un premier filtre appelé bac de décantation (placé dans la première cuve) va épurer et se débarrasser des grosses particules solides que contient l’eau (feuilles, morceaux de branches, etc...) par un procédé de décantation : les déchets vont aller au fond du bac, et l'eau qui s'en écoulera sera assainie. Un deuxième filtre, placé en sortie du bac de décantation, empêche les fines particules de passer.
 Dans la maison, il existe deux circuits d’eau complètement séparés pour que l’eau de pluie ne salisse pas l’eau potable, lorsque les cuves sont vides, le circuit d’eau potable de la maison prend le relais dans les toilettes et l’arrosage du jardin.
Dans la maison, il existe deux circuits d’eau complètement séparés pour que l’eau de pluie ne salisse pas l’eau potable, lorsque les cuves sont vides, le circuit d’eau potable de la maison prend le relais dans les toilettes et l’arrosage du jardin.
1 : Gouttière
2 : Bac de décantation
3 : Filtre à fines particules
4 : Cuve de 1m3
5 : Cuve de 2m3
6 : Evacuation de l’eau dans la terre
7 : Pompe à eau
8 : WC
- Comme pour les panneaux thermiques, une installation de panneaux solaires photovoltaïques nécessite l’approbation de la mairie de la commune concernée par l’installation.
Aujourd’hui, les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés de deux manières différentes :
Tout d’abord, l’électricité récupérée peut alimenter directement les installations électriques de la maison. Mais cette utilisation n’est pas très rentable : les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire en un courant électrique de 12 Volt de tension, alors que beaucoup d’appareils utilisent des courants de tension bien plus élevée.
Ou bien l’électricité produite par les panneaux est directement revendue à EDF (par la borne existant dans la rue ou le quartier) : c’est une utilisation plus rentable car EDF est obligé d’acheter cette énergie ; ils la rachètent 53 centimes d’euro/ kiloWatt. C’est donc cette utilisation des panneaux photovoltaïques que nous avons choisie.
Fonctionnement des panneaux photovoltaïques :
Les panneaux solaires photovoltaïques sont constitués de cellules qu’on appelle « photopiles » : elles sont composées de matériaux semi-conducteurs, c'est-à-dire qu’ils ne laissent passer le courant que dans un sens, comme une diode. Le matériau le plus souvent utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques est le silicium. Les photopiles transforment la lumière en électricité.
Les photons (particules de lumière) viennent se heurter aux cellules photovoltaïques et transmettent leur énergie aux électrons du silicium : celui-ci, qui joue le même rôle qu’une diode, va diriger tous les électrons dans le même sens (comme dans un circuit électrique). Ainsi, une tension va apparaître aux bornes de chaque photopile. Donc la lumière du soleil est transformée en vrai circuit électrique à l’intérieur du panneau : c’est un courant continu d’une tension de 12 Volts. Ce courant est envoyé vers la batterie de stockage en passant par le régulateur de charge appelé aussi onduleur : il va protéger la batterie en cas de surcharge en coupant très brièvement le courant qui la traverse.
Installation des panneaux photovoltaïques :
Afin d'optimiser la capacité de production des panneaux, on veillera à leur bonne orientation vers le sud et à une inclinaison leur permettant de capter le plus de lumière possible. Comme pour les panneaux thermiques, il faut orienter les panneaux photovoltaïques plein sud et les incliner à 30° par rapport à l’horizontale, pour un meilleur rendement.
Faire installer des panneaux solaires revient relativement cher en fonction des éléments qui le composent : en général, 1m² de panneaux solaires photovoltaïques coûte dans les 250 à 300 €3. Mais dans le commerce, ils sont souvent vendus par 2 m², donc il faut compter dans les 300 à 500 €. Si l’on choisit de revendre l’électricité produite directement à EDF, comme nous souhaitons le faire, il faut utiliser un autre type de panneaux : 1 m² de ces panneaux photovoltaïques coûte alors environ 500 €. Etant donné que 10 m² de ces panneaux photovoltaïques produisent environ 10 KWatt/jour, on peut en déduire que 1 m² produit 1 KWatt/jour. Sachant qu’EDF rachète l’électricité solaire 0,53 centime/KW, et que notre maison utilise 2 m² de panneaux photovoltaïques, on peut effectuer un calcul de rendement :
- Calcul du rendement :
2 x 0,53 = 1,06 €, donc environ 1,6 € /jour.
1,06 x 30 = 31,8 €, on gagne donc environ 31,8 € /mois.
31,8 x 12 = 381,6 €, ce qui fait environ 381,6 € /an.
Donc, étant donné que 2 m² de panneaux photovoltaïques vont coûter environ 1 000 €, si leur rendement respecte plus ou moins cette moyenne, leur investissement sera remboursé en moins de trois ans, et au-delà, ils permettront d’importantes économies sur l’électricité.
• L’économie d’électricité passe aussi par les ampoules et les appareils électriques
Afin d’économiser l’électricité, on peut utiliser des lampes à basse consommation (LBC). Elles fonctionnent avec des ampoules fluorescentes alors que les lampes classiques fonctionnent avec des ampoules à incandescence.
La LBC consomme jusqu’à 5 fois moins d’énergie que la classique et dure jusqu’à 15 fois plus longtemps, ce qui permet d’amortir son coût qui est 5 à 7 fois supérieur. La LBC a pour inconvénients de mettre un certain temps à atteindre sa luminosité maximale et d’avoir une luminosité « froide ». Mais ces inconvénients vont bientôt être réglés.
Les LED vont arriver sur le marché : elles consommeront 2 à 4 fois moins que les LBC pour une luminosité équivalente.
Pour l’instant la technologie n’est pas au point, on est obligé pour les fabriquer, d’utiliser des matériaux rares comme l’or, donc elles coûtent cher et n’éclairent pas beaucoup, elles sont pour l’instant utilisées pour les témoins de veilles.
Pour savoir si l’on achète une lampe qui nous fera économiser de l’énergie et de l’argent, il suffit de lire l’étiquette énergétique obligatoire sur l’emballage depuis l’an 2000, la classe « A » étant attribuée aux lampes les plus performantes.
L’ADEME a lancé une opération de « sensibilisation aux Etiquettes Energie » pour que soient collées ces étiquettes, sur tous les appareils proposés en magasin pour permettre au client de mieux apprécier son investissement. Acheter un appareil de classe A, c’est faire un geste pour l’environnement, mais aussi économiser environ 20% sur la facture d’électricité.
Economies en éclairage et confort visuel
Comme nous l’avons déjà vu, un des principes fondamentaux de la construction environnementale est la recherche d’un certain confort dans l’habitat tout en privilégiant les économies d’énergie et la protection de l’environnement. Une maison environnementale se distingue principalement des autres constructions classiques par l’importante utilisation de la lumière naturelle, comme nous avons pu le constater grâce à la pose de panneaux thermiques (voir économies d’énergie : le chauffage) ou photovoltaïques (voir économies d’énergie : l’électricité), mais aussi grâce à de nombreuses surfaces vitrées facilitant la pénétration de la lumière solaire dans les pièces.
• Une utilisation accrue de la lumière solaire
La lumière du soleil est un des premiers facteurs à prendre en compte dans la réalisation d’une maison, d’autant plus lorsque cette maison est environnementale, comme nous avons pu le voir (article : plan/Plan de masse), lorsque nous devions définir l’emplacement et l’orientation de chaque pièce par rapport à leur rôle et à l’ensoleillement qui leur était nécessaire.
Mais pour que cette orientation soit utile, il faut adapter les surfaces vitrées de la maison en conséquence. Ainsi, il faut distinguer la façade sud et la façade nord du bâtiment, qui ne seront pas aménagées de la même manière.
Sur les façades sud-est et sud-ouest sont également placées de larges surfaces vitrées, comme deux grandes portes vitrées, ou bien de grandes fenêtres, facilitant ainsi le passage de la lumière solaire dans les autres pièces.
• Une occultation de la lumière solaire néanmoins nécessaire
Même si la maximisation du nombre de surfaces vitrées est une chose importante dans une maison environnementale afin de capter la lumière solaire pour l’éclairage et le chauffage, il faut cependant penser à certaines choses : en été, là où l’ensoleillement est très intense et la température élevée, une grande quantité de fenêtres pourrait avoir comme effet d’aveugler les occupants du bâtiment, et de provoquer un effet de serre si important que la chaleur intérieure serait intenable.
C’est pourquoi nous avons décidé de trouver un moyen efficace de protection contre la lumière du soleil, et ce dans le but principal de participer à l’optimisation du confort visuel et thermique des habitants.
Nous avons d’abord pensé à utiliser des végétaux afin de préserver les façades de la maison contre la chaleur, le froid, mais aussi le vent, car ceux-ci ont effectivement l’avantage de protéger en été, puis de disparaître en hiver (pour les feuillus) et de laisser passer la lumière du soleil et la chaleur. Mais ce type de protection a ses inconvénients, car par exemple, un arbre placé devant une fenêtre ou un baie vitrée, même en hiver, empêcherait immanquablement le passage des rayons solaires dans la pièce.
De plus, ce type de choix de protection nécessiterait l’entretien des plantes, et pourrait causer, à long terme ou lors d’une tempête, d’importants dommages sur le bâtiment, risque qu’il vaut mieux ne pas courir.
La solution que nous avons donc choisie consiste en deux points :
Nous allons réaliser, sur notre projet de maison, une avancée de toiture d’environ 50 cm ; en effet, les avancées de toiture préservent des surchauffes estivales, tout en offrant un ensoleillement suffisant en période hivernale (le soleil étant plus bas dans le ciel en hiver qu’en été). De plus, les avancées de toiture protégent également de la plupart des vents, celles-ci agissant comme des « coupe vent ».
L’autre point à développer consiste en la pose de volets. En effet, une protection efficace nécessiterait la fermeture complète des volets ; or, fermer les volets au cours de la journée réduit la luminosité dans le bâtiment, c’est pourquoi il est essentiel de trouver des volets qui auraient la capacité de préserver d’un ensoleillement intense en plein jour sans pour autant masquer la lumière. Nous avons donc décidé de placer, sur toutes les fenêtres et les portes extérieures (celles-ci étant vitrées), des stores extérieurs réglables, et ce afin de pouvoir choisir l’éclairage adéquat. Ces stores sont constitués de plusieurs lamelles de pin maritime traitées au sel de bore (voir structures/matériaux : traitement écologique du bois) disposées horizontalement et parallèlement les unes aux autres, et reliées entre elles par un cordon épais. Ces stores, qui reprennent le principe des stores vénitiens, peuvent être réglés au niveau de leur hauteur, ainsi que de l’inclinaison des lamelles pour faire varier l’éclairage dans chaque pièce. On obtiendrait alors un ensoleillement réglé et filtré sur demande, qui participerait à un meilleur confort visuel (et thermique) chez l’occupant de la maison.
1. conduction : action de transmettre de proche en proche
2. Toutefois plusieurs spécialistes émettent des réserves quant à ce système, peu compatible, d’après eux, avec l’humidité de la région aquitaine.
3. Données 2008 en Aquitaine
La façade étant située le plus au Nord sera pourvue d’une quantité de surfaces vitrées moindre. En effet, l’ensoleillement y est beaucoup moins important qu’au Sud, et les pièces exposées au Nord ne doivent pas avoir de grandes ouvertures pour éviter de se refroidir au contact du vent froid en provenance du Nord. De part cette fonctionnalité, on appellera ces pièces des «espaces tampons», car elles protègent le reste de la maison d’une perte d’énergie thermique. De plus, les pièces situées au Nord, par exemple les chambres, le bureau ou la buanderie, pourront ainsi profiter de davantage de fraîcheur et d’un éclairage atténué, ce qui confèrera aux pièces une atmosphère plus agréable et confortable.
La façade la plus exposée au sud sera largement vitrée, pour recevoir un maximum d’éclairage tout au long de la journée (les pièces placées au sud étant les pièces principales de la maison) et pour emmagasiner la chaleur. Afin de satisfaire ces deux besoins, nous avons placé une large baie vitrée à l’étage, exposée au Sud ; cette baie vitrée agit comme une véranda : elle laisse passer une très grande quantité de lumière, qui est ensuite répartie dans la salle à manger, grâce au puits de jour, et elle permet un chauffage naturel de la maison, grâce à l’effet de serre qu’elle produit ; cette chaleur est ensuite stockée et répartie dans le bâtiment grâce au mur en briques à forte inertie thermique (voir économies d’énergie :’isolation écologique).
Conclusion : En Aquitaine, 1m3 d’eau est facturé 2€73 par la Lyonnaise des Eaux, rien que pour les toilettes le ménage (4 personnes) économisera environ 65€ par an et 12.6 m3 d’eau. Si tout le monde récupérait l’eau de pluie, la France économiserait énormément d’eau douce.
496 * 4 * 12 = 23.808 m3 23.808 * 2.73 = 65 €
L’Électricité dans la maison
• Les panneaux photovoltaïques
L’énergie photovoltaïque devient très utile de nos jours, notamment dans les pays en développement qui n’ont pas assez d’argent pour élaborer des réseaux d’électricité. Elle peut également apporter de l’électricité dans des zones isolées.
Utilisation
Les conditions d’utilisation des panneaux solaires photovoltaïques sont relativement similaires à celles des panneaux solaires thermiques :
- Il faut les installer sur un toit ou en hauteur.
- Il faut éviter la proximité d’arbres ou de bâtiments susceptibles de créer de l’ombre aux panneaux, d’autant que les panneaux photovoltaïques ne captent que 15 à 20 % de la lumière solaire, ce qui est trois fois moins que les thermiques, donc il ont davantage besoin d’une exposition totale au soleil.
- Ils ont besoin, pour un rendement efficace au maximum, d’une inclinaison idéale par rapport à l’horizontal et au soleil ; comme nous l’avons dit, en Aquitaine, cette inclinaison est de 30° à 32° (pour notre maquette, 30°).


 Dans la maison, il existe deux circuits d’eau complètement séparés pour que l’eau de pluie ne salisse pas l’eau potable, lorsque les cuves sont vides, le circuit d’eau potable de la maison prend le relais dans les toilettes et l’arrosage du jardin.
Dans la maison, il existe deux circuits d’eau complètement séparés pour que l’eau de pluie ne salisse pas l’eau potable, lorsque les cuves sont vides, le circuit d’eau potable de la maison prend le relais dans les toilettes et l’arrosage du jardin.